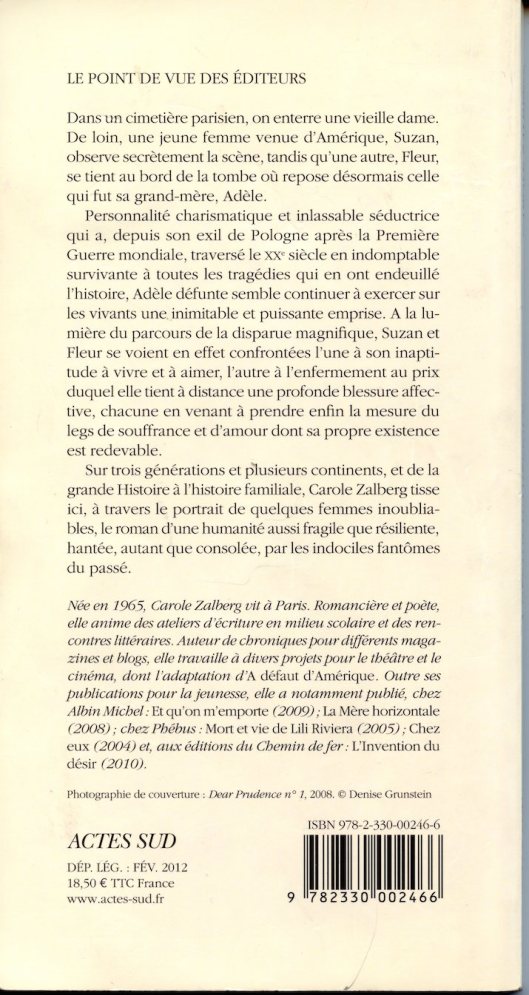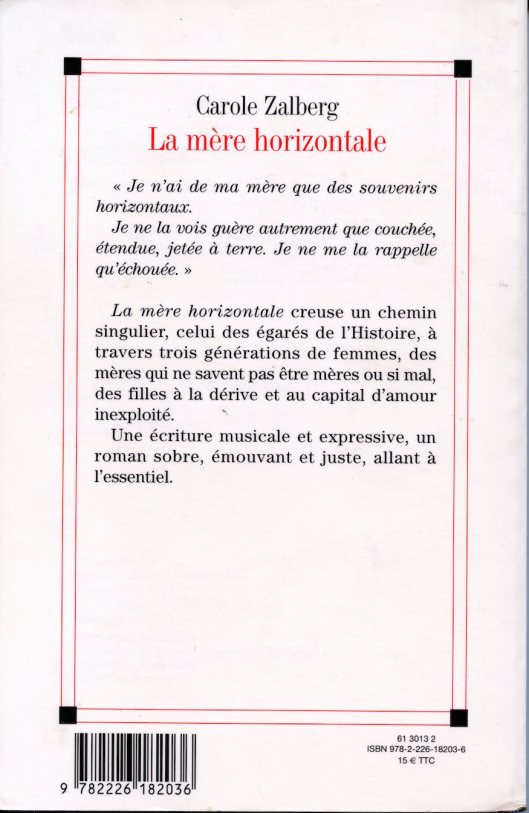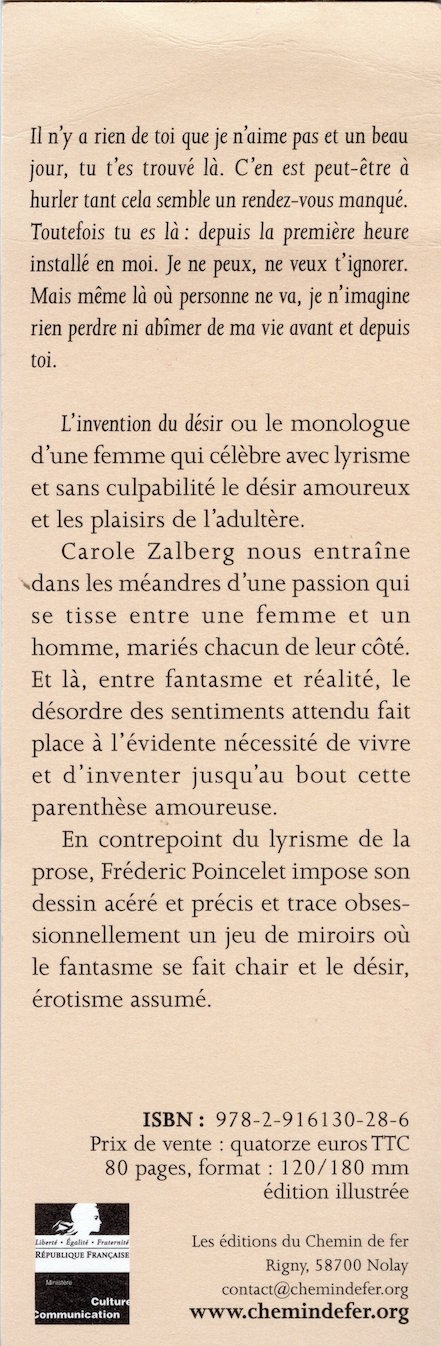Étiquettes
L’amour au temps de la Libération
Deux femmes — Suzan et Fleur — se parlent à travers les pages du livre ou, si l’on veut, à travers un mur invisible nommé Océan Atlantique. Chacune d’elles dispose de trente-six répliques pour atteindre son but intime. À chaque réplique, l’une et l’autre lancent et relancent un boulet contre ce mur. On dirait qu’elles jouent à la pelote basque. La plupart des fois la petite sphère rebondit en arrière, mais il arrive aussi, de temps en temps, que l’Amérique vienne à Paris ou que Paris se déplace pour un séjour bref en Amérique. En ces cas uniques, le boulet a réussi à percer le mur. Mais les deux mondes ne peuvent vraiment se parler, parce que ce n’est pas seulement la géographie qui creuse les sillons et fabrique les distances. C’est surtout la vie qui sépare, lentement, insensiblement même les plus opiniâtres des amants perdus.
Et voilà le prétexte, la première occasion qui pousse l’Américaine Suzan et la Française Fleur, chacune de sa rive, à se retourner vers le passé pour y retrouver un sens à son existence : c’est un grand amour. Un amour qui n’a pas pu s’épanouir et s’exploiter au moment de la première rencontre d’Adèle avec Stanley, à Paris, tout de suite après la Libération. Cependant, en restant suspendu dans l’air comme un fruit interdit, cet amour avait fini pour se « cristalliser », comme dirait Stendhal, en déclenchant une nostalgie presque impossible à cicatriser.
« My name is Stanley. Il avait saisi la main d’Adèle et dans cet instant, ne voyant plus que le sourire et le regard de ce garçon, son corps tout entier rassemblé dans ses doigts qu’elle le laissait étreindre, elle oublia qu’elle était une mère dévastée, une épouse aimante en charge d’un destin, une femme déjà prise et pas qu’un peu ». (Page 167)
Suzan et Fleur, entre les lignes, se posent une question : « Y a-t-il eu peut-être, en 1945, en quelque forme un ménage à trois entre Adèle, Stanley et Louis ? » C’est la seule chose dont on ne parle pas dans le livre. D’ailleurs, ce serait difficile d’imaginer cette rencontre américaine d’Adèle et Stanley — à la distance de cinquante ans, à peu près — sans que rien soit passé entre eux.
Toutes les deux recherchent, peut-être, les fameuses « lettres compromettantes », mais elles ne les trouvent pas. Cependant, cette question du « grand amour » les inquiète : « Que serait-il arrivé — se demande Suzan — si mon père avait abandonné sa carrière pour suivre cette Française capricieuse ? Je ne serais pas née… Mais ! » De l’autre côté de l’occident Fleur, en revanche, se demande : « Que serait-il arrivé si ma grand-mère avait abandonné mon grand-père pour suivre ce Yankee musclé ? »
En fait, le roman est net sur ce point. Dès la première rencontre, Adèle n’avait pas caché l’existence d’un lien amoureux dont elle n’aurait pas pu se passer :
« Et puis elle avait dit “avec Louis, mon mari” et il avait su sans comprendre le mot lui-même qu’il était en retard d’une vie. Les images heureuses et brûlantes avaient voleté encore un peu en bourdonnant sous son crâne. Il avait failli se trouver mal et Adèle s’en était aperçue. Are you OK ? avait-elle réussi à demander. Vous êtes blanc comme un drap ! Venez, nous sommes à deux pas de chez moi. Je vous donnerai à boire. Pas question que je vous laisse repartir avant de vous avoir remis sur pied ». (Page 168)
Le « grand amour », qu’on appelle par ce titre de « grand » pour avoir subi quelques empêchements (comme Juliette Drouet avec Victor Hugo), ou pour avoir été décidément fauché (comme Abélard avec Héloïse) rarement s’achève dans le bonheur inoffensif, comme il arrive pourtant à Fermina Dàza et Florentino Ariza dans L’amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Car il devient le plus souvent (comme dans le cas de Baptiste et Garance des « Enfants du paradis ») un long et obsessionnel « roman de la mémoire » pour les directs intéressés et une espèce de boîte miraculeuse pour la multitude de curieux et de spectateurs qui voudraient y trouver un reflet de leur « grand amour » personnel. Ou bien, comme c’est le cas de la grand-mère Emma, qui choisit de ne pas y renoncer, c’est un bonheur dangereux et producteur de désastres. Par conséquent il est conditionné, piégé et de toute part menacé.
D’ailleurs, même dans le couple pionnier de Kreindla et Szmul il y a eu un moment critique aussi redoutable que les preuves infinies venant de la persécution, de la détresse et de l’exil. Et c’est l’amour qui l’a provoqué. L’amour presque innocent de Szmul et Mira, qui toutefois a hanté le destin de cette jeune famille, fraîche immigrée, comme une bombe à retardement capable de produire des dégâts irréversibles.
S’il n’y avait eu la volonté et la générosité de Kreindla, le destin de Szmul se serait peut-être rapproché à celui d’Emma, la fille d’Adèle que nous avons connue comme grand-mère de Fleur. Ainsi celui d’Adèle. S’il n’y avait pas eu les emportements de Louis, son mari jaloux et pourtant compréhensif. Toute dérive vers le désastre et la solitude passe toujours par l’absence de compréhension et de pardon de nos proches.
Le nouveau regard de Carole Zalberg
Notre auteure a bien sûr considéré la question de la diminution de l’écoute et de l’attention de la plupart des lecteurs de romans, en France et dans le monde.
Cependant, je crois que c’est surtout le thème de l’amour — de la difficulté d’en parler de façon équilibrée, se dérobant à toute envie d’indiscrétion et de la nécessité, au contraire, de se borner au maximum de respect possible — ce qui a dicté les contraintes que Carole Zalberg s’est obligée à suivre dans la quête de vérité et de chaleur familiale qui prend des formes différentes en passant d’un roman à l’autre de la Trilogie des tombeaux.
Cette nouvelle « mise en scène » littéraire, ce bouleversement dans la forme, la longueur et la structure même de l’écriture que Carole Zalberg réalise, s’organise à travers une fragmentation picto-filmique (Mondrian et les peintres futuristes pour les arts plastiques ; L’année dernière à Marienbad d’Alain Resnais [1961], The hours de Stephen Daldry [2001] et Short cuts de Robert Altman [1993] pour le cinéma). Mais ce bouleversement ressent aussi, sur le plan littéraire de la leçon : de Virginia Woolf pour cette rêverie vertigineuse liée au flux du temps ; de José Saramago et Jerôme Ferrari pour le rythme, la récupération de la tradition orale de la langue, la disparition des virgules et de tout tiret ou guillemets.
Avec cet esprit, à commencer par La mère horizontale, un « nouveau roman » est né. Et, chose vraiment surprenante, dès que ce premier livre est publié, la trilogie évolue, se transforme et prend des formes nouvelles au fur et à mesure que le sujet de la narration, d’un livre à l’autre, nécessairement change. Et change aussi le regard de Fleur, la dernière née, que son prénom désigne justement comme « le meilleur » dans sa famille.
Dans La mère horizontale, le regard de Fleur ne saisit presque jamais les personnages dans une action qui se déroule au dehors de sa mémoire et de son imagination. En suivant son regard, à la fois très rapproché de sa mère et très éloigné des autres personnages — selon des séquences qui rappellent de près le cinéma d’Alain Resnais —, le lecteur devient de plus en plus « libre » de juger et de pardonner, redonnant enfin à chaque histoire racontée leur dignité et vérité.
À cet éloignement du regard, Carol Zalberg ajoute un deuxième éloignement, en déplaçant les évènements racontés au dehors de toute chronologie et précision narrative. C’est un critère « transgressif » et inhabituel, qui sert à raconter des histoires « par tableaux de vie », tout en réclamant la participation du lecteur à la recherche d’un ordre qui puisse le satisfaire. Tout cela correspond d’ailleurs au sentiment magnanime de Fleur, à son esprit tout à fait démocratique.
Avec Et qu’on m’emporte, une espèce de règlement de comptes généalogique s’achève, qui avait été un des soucis de Fleur. En tout cas dans ce deuxième roman la quête de vérité et de pardon trouve une forme différente vis-à-vis du précédent. Fleur n’est plus seule à voir et raconter. Il y a un deuxième pilote. Une deuxième voix. Carole Zalberg trouve ici une solution de compromis entre la croissante exigence de fiction et le regard magnanime, respectueux et éloigné de Fleur ou, pour mieux dire, entre la demande de visibilité des personnages et les contraintes dictées par ses tabous sur les secrets de famille.
Mais la digue commence à se briser et finalement le personnage cible de ce deuxième volet, Emma, grand-mère de Fleur, raconte, explique, avoue, demande pardon, pardonne à sa fois. Elle est un personnage très discuté, le plus difficile de toute la lignée. Emma se défend, au nom de cet amour sans lequel elle serait morte. Pour cette partie du triptyque, dans laquelle les plans de la mémoire s’entrecroisent librement — avec une présence de l’auteure encore plus passionnée —, j’ai pensé au film de Stephen Daldry, The hours, soit pour la structure narrative du film soit pour les références à Mrs Dalloway et à Virginia Woolf. L’écrivaine à laquelle Carole Zalberg est en train de s’approcher de plus en plus.
Dans À défaut d’Amérique, une révolution copernicienne s’affirme avec le doublement du regard que notre écrivaine met en place donnant la parole — et l’action — à Suzan, faisant sortir ainsi cette histoire de sa dimension strictement familiale et mettant en cause toute l’architecture narrative précédente.
Maintenant, Fleur et Suzan ont le même espace et le même temps pour s’exprimer. Mais cette nouveauté dans les règles du jeu déclenche un procès à chaîne qu’on ne peut plus arrêter, lié au choix du numéro deux. Ce numéro décrit d’abord l’essence d’un couple — deux amants qui deviennent deux parents —, l’éternel affrontement du Bien contre le Mal, et aussi la séparation et la difficulté de dialogue entre les peuples.
Emblématique, sur ce propos, l’image de cette Amérique survivante à ses gloires passées qui vit son quotidien dans les pages de gauche, tandis que dans les pages de droite une Europe en difficulté essaie de maîtriser les suites centrifuges de l’écroulement du mur de Berlin. Au centre, là où le lecteur serre le livre de son pouce, bouillonne l’océan.
Mais ce numéro deux aide aussi notre écrivaine à balancer, comme dans une partition musicale, le rôle du soliste — joué la plupart des fois par Suzan — et le rôle du chœur ou de l’orchestre, dirigé par Fleur. Il éclaircit aussi les diverses fonctions narratives : Suzan agira sur le destin, essayant de le changer ou quand même d’en ralentir le rythme implacable, Fleur recommencera l’histoire de la famille « da capo », c’est-à-dire à partir des premiers pas de la petite Adèle qui en définitive n’est qu’une lointaine arrière-grand-mère. Les deux femmes n’ont pas trop de temps à disposition. Suzan doit raconter la visite à Palm Beach, qu’elle-même a provoquée, de la vieille Adèle, veuve et libre, que son père Stanley n’a cessé d’aimer. Fleur doit raconter l’après-Grande Guerre, le déplacement à Paris, la tragédie de l’Europe. Tandis que Fleur redescend du passé vers le présent, Suzan se déplace sur le passage du millenium fouillant elle aussi, sans aucun souci d’ordre chronologique, dans le passé de Stanley, pour se raconter pour la énième fois comment s’est passée la fameuse rencontre avec Adèle. Parfois, avec un hasard très bien maîtrisé, Carole Zalberg nous rapproche, d’une page à l’autre, d’une rive à l’autre, des souvenirs qui se touchent, se reconnaissent et se confrontent. À la page 73, par exemple, elle nous peint admirablement Stanley sur son lit de mort, en train de pleurer sur les photos abîmées d’Adèle, tandis que tout de suite après, à la page 74, elle nous parle de Louis, celui qui fut le mari d’Adèle, en train d’arriver lui aussi à Paris, jeune et fort, le banjo à la main.
Carole Zalberg a su faire front à un défi énorme. Comme dans la peinture, où il suffit de changer un particulier d’une main, d’un pied, passer une couche de bleu sur un petit coin qui était rouge, et le tableau se déséquilibre, elle s’est trouvée devant un nouveau vide à combler, une énième course à engager.
Mais ce n’était pas, pour elle, un problème à se creuser les méninges. Car la structure qu’elle avait créée, même dans sa complexité, lui donnait la possibilité de lancer une contre-offensive de la parole, et, surtout, une révolte des émotions. Elle a su faire ressortir ainsi — fragment après fragment — l’émotion et la pulsion authentiques de chaque personnage et de chaque histoire, leur redonnant la vie comme à des figures jaillissant d’un immense tableau. Des figures en train d’atteindre la rive, accrochées à des tessons de couleurs comme à des épaves dans un bénéfique naufrage.
Deux personnages masculins : Stanley et Szmul
Dans un des premiers commentaires à ce dernier roman de Carole Zalberg, Emmanuelle Caminade a écrit dans son blog (« L’or de livres ») qu’ici « les hommes ne sont pas absents, mais plutôt pâles et faibles ». Cela est possible. Cependant, les personnages masculins du roman sont surtout justes et nécessaires.
Ils font d’ailleurs de pendant à Fleur, l’invisible et presque muette messagère d’amour virtuel, en faisant souvent démarrer les passages les plus importants de l’action narrée : l’Américain Stanley, entrant dans le foyer meurtri de rue Beaubourg comme un éléphant dans une vitrine ; Szmul, mettant en marche, avec son ami Mendel, le petit « train de vie » en exile ; Louis emmenant la force et la joie de vivre des gitans errants.
Sur Louis je n’ai pas trouvé, ni cherché, trop de suggestions sur la fonction narrative de son prénom, qu’en revanche j’avais trouvé pour la plupart des personnages du livre (de Fleur à Emma ; de Suzan à Sabine ; de Lisa à Kreindla, et cetera), avec des traces très intéressantes sur Stanley et Szmul.
Stanley c’est le prénom de ce héros du débarquement en Normandie qui avait goûté la gloire dans ce Paris libéré qui fêtait la joie de vivre, de cet Américain qui, pendant cinquante ans, n’avait cessé de songer à rattraper cette Adèle perdue. Probablement, Carole Zalberg a choisi ce prénom en hommage au protagoniste d’Un tramway nommé Désir de Tennessee William, dont Elia Kazan tira le film homonyme en 1951 (L’invention du désir est d’ailleurs le titre d’un roman récent de Carole Zalberg).
En vérité, en lisant le roman, on ne pense pas à la silhouette et à la grimace de Marlon Brando. Mais le personnage du film, Stanley Kowalsky, ouvrier américain d’origine polonaise, peut bien rappeler le Stanley du livre — d’origine polonaise et fanatique des États-Unis lui aussi. On trouve aussi de fortes ressemblances entre Stella, femme de Stanley dans le film et Lisa, femme de Stanley et mère de Suzan dans le roman. Intéressante est aussi la coïncidence que prévoit l’arrivée à La Nouvelle-Orléans de Blanche Dubois (Vivien Leigh), venue de la France pour rejoindre sa sœur. Un voyage analogue à celui qu’Adèle aussi a fait aux derniers temps de sa vie et qui représente la situation clou du roman.
« La garce ! n’avait pas pu s’empêcher de penser Suzan chaque fois que son père avait repris son récit nostalgique. Tout ça pour le laisser en plan. Et lui qui n’éprouvait pas le moindre petit soupçon de rancœur. Mais tout ce rituel était pour lui si éprouvant qu’ensuite il s’endormait là, sur le canapé du salon, le grand album des retrouvailles recouvrant ses jambes tel un plaid anguleux. Si Suzan, afin qu’il puisse s’étendre, cherchait à le lui ôter, il parvenait, du fond de son sommeil, avec une force qu’en le voyant ronfloter le menton sur la poitrine on n’aurait pas attendue de lui, à lui saisir le poignet pour arrêter son geste. Suzan n’insistait pas. Que faire à part repartir chaque fois en pestant ? Son père devait aimer sentir le poids du souvenir sur ses genoux ». (Page 73)
Avec cette image tout à fait possible d’un double de Marlon Brando vieux, assisté par sa fille dévote, qui scrute les photos de son rêve échoué, Carole n’aurait pu nous donner d’images plus touchantes et douces que celles-ci sur cet homme au couchant de sa vie.
Quant à Szmul, il est le héros caché du roman : « J’ai tué d’autres juifs dans leur guerre. C’est ce que Szmul a dit quand il est finalement rentré rue Nalewky ». (Page 25) Déjà, la Grande Guerre lui ouvre les yeux : « J’ai tué d’autres juifs pour eux et qu’est-ce qu’ils on fait, Kreindla, ces ignorants qui donnaient les ordres, ces pelures d’hommes qui se prennent pour des dieux ? Tu le sais, Kreindla, ma femme, ce qu’ils ont fait quand ils m’ont trouvé en lamentation, à me tordre les mains et m’arracher les cheveux sans espérer le pardon ? Tu sais ce que ces bien moins qu’hommes ont fait, Kreindla ? Ils ont ri, quoi d’autre ? Ils m’ont craché dessus. Et moi, j’ai pensé : Encore, et piétinez-moi, même. Parce que le fusil, Kreindla, c’est moi qui le tenais. J’avais le choix. Dieu laisse toujours le choix. J’aurais pu retourner le fusil contre moi ». (Page 26)
Il est sensible plus que beaucoup d’autres. Donc il prévoit en avance ce qui arrivera en Pologne et en Europe, d’abord pour les juifs, qu’on coincera de plus en plus dans les ghettos en les empêchant de vivre une vie normale. Heureusement, il n’est pas seul. Il peut se confier avec un ami, Mendel, moins sensible que lui, mais prêt à partager ses inquiétudes et se faire promoteur de tous les efforts nécessaires pour s’en sortir. Szmul et Mendel sont comme deux frères. Ils partagent tout, même le parapluie. Leurs femmes sont soudées. Lorsque Mendel (dont le prénom d’un grand homme de science marque un très positif esprit « évolutionniste ») trouve la piste de l’Amérique dans laquelle s’engager pas seulement pour survivre, mais pour vivre mieux, « L’heure venue, il a pourtant suivi son compagnon de parapluie » (Page 31)
Par la suite, Carole peindra Szmul comme un homme brisé, tourmenté. Un poisson hors de l’eau. Mais pas du tout un héros. Jusqu’à sa mort, tout à fait « banale » : « Mon Szmul est mort de toux ! et sa vieille bouche, elle était encore ouverte et tordue et comment je fais, moi, pour que les mouches et les esprits mauvais, ils n’y entrent pas ? » (Page 107)
Cependant, ici la recherche sur le prénom a été plus directe, moins hasardeuse et beaucoup plus touchante. Avec Szmul, nous n’avons pas affaire avec un personnage de film (Stanley) ou une lointaine figure de la Bible (Suzan).
Szmul Zygielbojm a vraiment existé. J’ai trouvé aussi, sur Google, une photo de ce héros au visage plein de souffrance. Polonais, il avait laissé Varsovie avec d’autres camarades après l’occupation allemande, pour essayer d’organiser quelques actions de résistance. Mais, au fur et à mesure que la situation du ghetto de Varsovie devenait la Shoah, il n’eut plus envie de rester en vie. Et voilà la lettre qu’il écrivit à Londres avant de se donner la mort le 12 mai 1943 (cf. Hiltel Seidman, « Du fond de l’abîme, Journal du ghetto de Varsovie », Pion, 1998. Traduit de l’hébreu et du yiddish par Nathan Weinstock.) :
« Derrière les murs du ghetto se déroule à présent le dernier acte d’une tragédie sans précédent dans l’Histoire. La responsabilité du forfait consistant à exterminer la totalité de la population juive de Pologne retombe au premier chef sur les exécutants ; mais, indirectement, elle rejaillit également sur l’humanité tout entière. Les nations et les gouvernements alliés n’ont entrepris jusqu’ici aucune action concrète pour arrêter le massacre. En acceptant d’assister passivement à l’extermination de millions d’êtres humains sans défense — les enfants, les femmes – et les hommes martyrisés — ces pays sont devenus les complices des criminels. […] Je ne puis me taire. Je ne peux pas rester en vie alors même que disparaissent les derniers restes du peuple juif de Pologne dont je suis le représentant. Mes camarades du ghetto de Varsovie ont succombé, l’arme au poing, dans un dernier élan héroïque. Il ne m’a pas été donné de mourir comme eux, ni avec eux. Mais ma vie leur appartient et j’appartiens à leur tombe commune. Par ma mort, je désire exprimer ma protestation la plus profonde contre la passivité avec laquelle le monde observe et permet l’extermination du peuple juif. Je suis conscient de la valeur infime d’une vie humaine, surtout au moment présent. Mais comme je n’ai pas réussi à le réaliser de mon vivant, peut-être ma mort pourra-t-elle contribuer à arracher à l’indifférence ceux qui peuvent et doivent agir pour sauver de l’extermination — ne fût-ce qu’en ce moment ultime — cette poignée de juifs polonais qui survivent encore. Ma vie appartient au peuple juif de Pologne et c’est pourquoi je lui en fais don. Je désire que l’infime résidu des millions de Juifs de Pologne resté en vie puisse survivre assez longtemps pour connaître, avec les masses polonaises, la Libération et qu’il puisse respirer dans un pays et un monde de liberté et de justice socialistes pour toutes ses peines et ses souffrances inhumaines. »
Giovanni Merloni