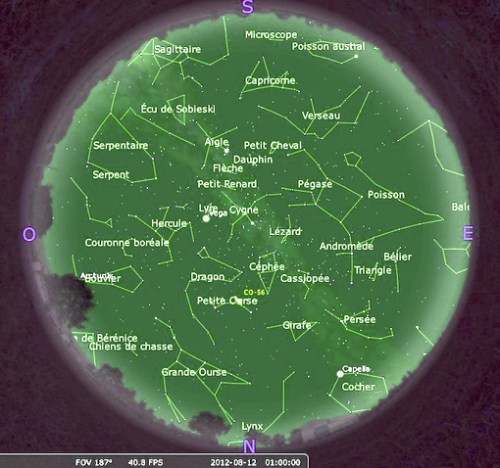« Pauvre maman ! Quelquefois, je m’arrête un instant pour regarder son visage perdu derrière le vol joyeux d’un oiseau et je me demande : qu’est-ce que la mémoire ? D’où vient-elle ? Où est-elle ? Le cerveau est-il la mère de la mémoire ? Ou bien la mémoire, comme une cathédrale gothique, représente-t-elle un monde à soi fait de petites briques sans nombre devant lequel le nom de celui qui conçut le projet initial s’est perdu pour toujours ? Ce qui compte, n’est-ce pas le résultat, l’œuvre colossale qui élève ses doigts frêles jusqu’à Dieu ?
La même chose, je crois, arrive à notre mémoire. Chacun de nous a un édifice dans sa tête : ce peut être un gratte-ciel américain, une pyramide égyptienne, une tombe étrusque ou une modeste chambre de bonne. En réalité, au-delà de l’aspect de l’édifice, chacune de ses briques est un monde enchâssé dans un autre, semblable et pourtant différent, comme un corail à l’intérieur d’une gigantesque barrière.
Et si la mémoire suivait un fil semblable à la bave des araignées ? Alors, après les pluies estivales, on s’étendrait parmi les feuilles, les buissons et les arbustes, dans les sous-bois, dans les jardins ou sur les terrasses et là où auparavant il y avait une obscurité confuse, apparaîtrait une trace luisante entremêlée à mille autres labyrinthes.
Peut-être que nous aussi nous marchons dans des galeries couvertes de stalagmites, parmi des toiles d’araignée. Voilà ce qui se produit à présent pour Henriette. Elle se perd dans ses galeries hors du temps, où chaque événement est entraîné dans des limbes.
Quelques-unes de ses boyaux sont meublées, d’autres dépouillées comme si une terrifiante épidémie était venue y sévir. Certaines des plus anciennes ont un toit voûté et quelques restes précieux du passé, tandis que dans les plus récentes les souvenirs liés au présent errent au gré du vent, comme des fantômes, ne laissant que de faibles traces, pareilles à des voiles déchirées.
Quand je vois ma mère dans la véranda, le regard enchanté dans une soudaine jeunesse, je ne me fais pas d’illusion. Je sais qu’elle s’est arrêtée dans une galerie et qu’elle est en pleine observation.
Henriette essaie de se lever, puis reste immobile en l’air. De quoi se souvient-elle, si sa mémoire s’effondre ? Pourtant, elle semble sourire…
Claudia_Patuzzi [La stanza di Garibaldi, Manni Editori, Lecce 2005].
Photo : Collection Frères Merloni. Reproduction interdite
Chère Catherine,
Hier soir, je t’avais envoyé par mail cet extrait, qui me paraissait très intéressant pour tout ce qu’on est en train de dire à propos de Pascoli, Zvanì, mon père et la table de Sogliano. Je te demandais si tu te rappelais du passage ci-dessus, de ce livre qui risque de passer inaperçu, qui pourtant parle de la précaire mémoire des vivants aussi vivement que du respect des morts, des exclus, des ratés : « Aucune charrue ne s’arrête parce qu’un homme meurt ». Ce fameux proverbe flamand, que l’écrivaine italienne met en valeur, a d’ailleurs inspiré La chute d’Icare, œuvre lumineuse de Pieter Brueghel Le Jeune que j’ai installé dans ma vitrine. Où est-il ce mort dont la charrue se passe ? Il est caché derrière les buissons et les arbres, on peut bien le voir si on aiguise un peu la vue… ou si l’on agrandit l’image plusieurs fois… Je voulais te parler de cette découverte, mais tu ne m’avais pas répondu.
Hier soir, Catherine, je me suis couché dans un piteux état. Heureusement, ce matin j’ai trouvé ton mail et d’un coup mon ciel nuageux s’est libéré.
Cependant, ces heures d’incertitude et de panne cérébrale m’ont fait comprendre que tu me manques.
Paradoxalement, ce fait de t’écrire, de t’avoir continûment dans l’esprit tel un alter ego — sévère ou bienveillante, apaisée ou heurtée selon la foulée que prend ma recherche — ne me rapproche pas vraiment de toi… Car effectivement il faut se voir dans la réalité, se serrer la main, cela est nécessaire pour confirmer, par des gestes et des regards significatifs, nos esprits, intentions, problèmes…
Malheureusement, au lieu de reprendre la saine habitude de se rencontrer dans un bistrot à mi-chemin, profitant de ce formidable transport commun parisien, nous vivons tous les deux cloîtrés… Moi, je me suis auto condamné dans ce bureau tour d’ivoire où je cultive l’illusion de poursuivre comme un nouveau Javert ce Jean Valjean que je porte en moi… Toi, en attendant que les effets de ta chute se calment, que ton épaule cesse de lancer de redoutables signaux et qu’enfin passe cette période d’incendies de caves et de colocataires cyniques…
Ton silence, d’ailleurs, m’a fait bien comprendre, sans que tes mots gentils de ce matin puissent me rassurer, que tu n’as pas été d’accord avec ma dernière publication.
Je suis d’accord avec toi. Il aurait été mieux écrire deux mots : « la documentation à disposition est largement incomplète, Zvanì n’a pas eu le temps, ou l’envie, d’aller plus loin. Il s’est borné à une longue liste, pleine de trous ». Ou alors essayer d’expliquer, en exploitant dans les détails les parties plus intéressantes. Je ne l’ai pas fait. En plus, de façon très banale, je l’admets, j’ai publié des photos assez typiques. Tout le monde possède des photos comme ça…
Et je n’avais pas ajouté non plus d’explications en dessous des photos comme, par exemple : « Zvanì à ses cinquante ans » ; « Zvanì et sa sœur Guerrina » ; « Les parents de Zvanì, Raffaele et Cleta »…
Je t’avoue que je n’ai pas dormi, cette nuit, ayant eu plusieurs fois l’impulsion farouche de courir à l’ordinateur pour supprimer l’article publié et déjà annoncé. Patience pour ces deux ou trois insomniaques qui ont eu la bonté de s’y rendre. Je leur expliquerai, me disais-je, je leur dirai que j’avais eu hâte de terminer le petit triptyque de la « petite grande histoire d’une famille », alors que ce travail était comme ci comme ça…
Heureusement, depuis cinq heures du matin j’ai plongé dans un sommeil très agréable, dans lequel j’ai probablement rêvé. Au réveil, dans le sombre de ma chambre qu’une timide lumière matinale interrompait par un halo blanc autour des rideaux… j’ai eu une petite fulguration. D’abord, je me suis rappelé de Blow up, l’incontournable film londonien de Michelangelo Antonioni et j’ai essayé d’en traduire le titre. Cela signifie, je crois, d’un côté « agrandissement » et, de l’autre, « explosion ». Dans ce film, Antonioni avait voulu se servir de la technique photographique et de ce « truc » de l’agrandissement pour exploiter un thème plus profond, métaphysique aussi, celui du mystère de la mort et de la mémoire.
Voilà, Catherine, c’était « inconscient », mais, au fond, c’était intentionnel ! J’ai fait un premier étalage des photos des personnages principaux de cette « petite grande histoire » pour « familiariser » le lecteur avec leur silhouette sinon carrément avec leur ombre. Et j’ai fait le même avec les « chapitres » de l’histoire de Zvanì. Car ce dernier ne pouvait pas avoir la force de se raconter jusqu’au bout. Ne dit-il pas d’ailleurs que cette histoire pourrait être racontée « en forme de récit aux petits-fils, au cours de vacances à la mer ou à la campagne » ? Ne dit-il pas que « leurs observations et questions pourront s’inspirer au monde d’aujourd’hui, cela nous aidera à faire des comparaisons et à développer des thèses » ?
Ma chère Catherine, je bénis ton silence, je m’agenouille devant cette sévérité tout à fait nécessaire. Car cette « liste » de Zvanì représente pour moi son « testament moral » et, en même temps, une piste pour fouiller avantageusement dans cette matière passionnante et insidieuse qui s’appelle « passé ».
Tu verras aussi — si tu ne l’as pas noté dans ta lecture que pourtant j’imagine attentive, même dans ton agacement — que cette « histoire » confirme tout ce qu’on disait à propos des ressemblances avec Pascoli. D’ailleurs ce sont les mêmes lieux, le même paysage, le même contexte.
Blow up. Voilà, j’agrandis cette photo de Zvanì. La vision de sa mise « sans façon », de sa veste manquante d’un bouton, de ses poches pleines de mouchoirs et de cartes, est en vérité moins importante, beaucoup moins importante de la vision claire de ses yeux.
Photo : Collection Frères Merloni. Reproduction interdite
En regardant cette photo, que je trouve correspondante à l’image incorporelle que mon père m’avait transmise de lui, je crois cueillir dans ces yeux une pensée parallèle. Celle que mon cousin Paolo P. aurait appelée « pensée mobile ». J’imagine Zvanì dans la pause d’un congrès très engageant, invité/obligé à se faire une photo. Dans ces deux ou trois secondes d’abstraction, au lieu de penser à la mort il pense à la vie. Pour se distraire il songe à cette époque entre 1880 et 1890 dont il aurait voulu parler à ses petits-fils (peut-être pas encore nés le jour de ce congrès, que je situerais dans les années tragiques 1924-1925 du délit Matteotti et de la retraite « à l’Aventin » des parlementaires démocrates), il remémore pour soi-même les guerres d’indépendance, les exploits des garibaldiens, les épisodes de sanglantes luttes locales en Romagne, le suicide, lié à ces dernières, de son oncle maternel, dont il avait entendu parler en termes vagues et mystérieux…
Photo : Collection Frères Merloni. Reproduction interdite
Cet agrandissement me pousse à fouiller. Comme dans le film d’Antonioni, j’ai comme le sentiment de quelques choses cachées [un cadavre dans le placard ?], quelques mystères…
Et s’il pensait à Icare, tombé dans l’eau dans le côté droit du tableau… au mort, à peine visible parmi les buissons, dans le côté gauche ?
Oui, pourquoi pas ? Si les morts viennent si fréquemment nous voir, s’ils nous font trouver des traces de plus en plus évidentes de leur vie, de leur fonction dans le monde, en nous aidant à mieux comprendre notre destin, pourquoi ne devraient-ils pas se charger de nos soucis, de nos penchants artistiques et culturels ?
Excuse-moi Catherine, si je dérape un peu. Mais je crois que dorénavant nous devons envisager un double passage. D’un côté, examiner les apparences, de l’autre côté nous arrêter, pour voir mieux, parmi les buissons réels ou métaphysiques, s’il y a un mort caché….
Giovanni Merloni
écrit ou proposé par : Giovanni Merloni 1ère mise en ligne 10 février 2013 Dernière modification 10 février 2013.
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 3.0 non transposé.