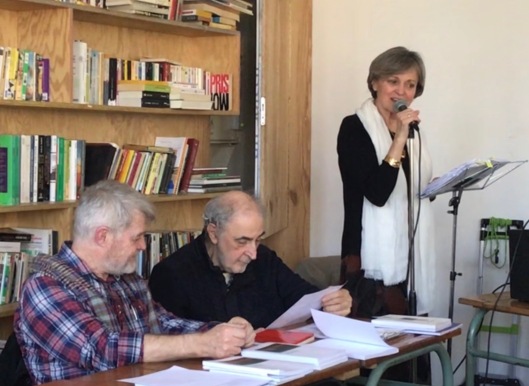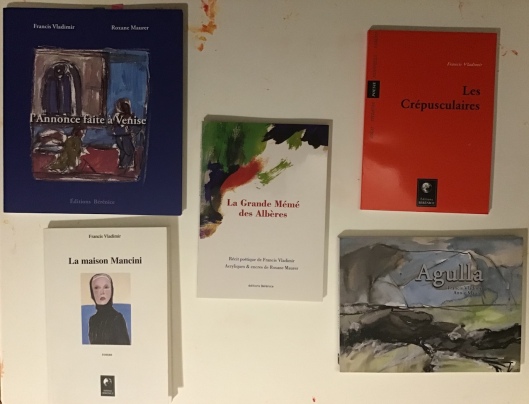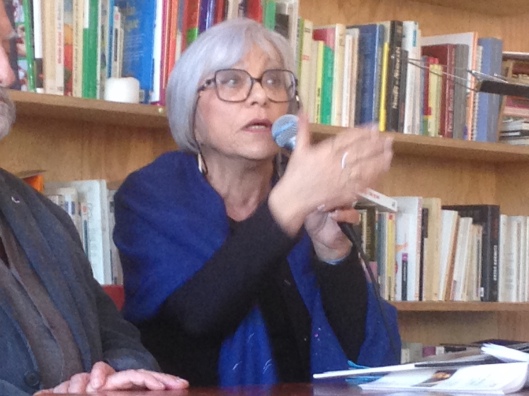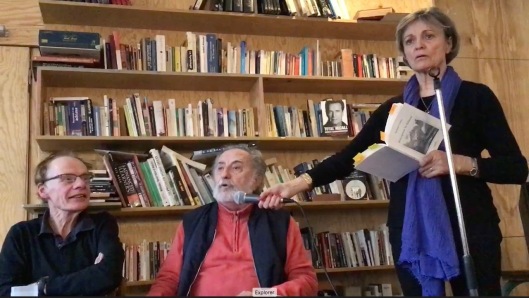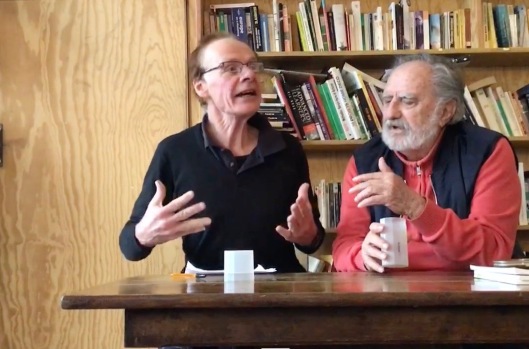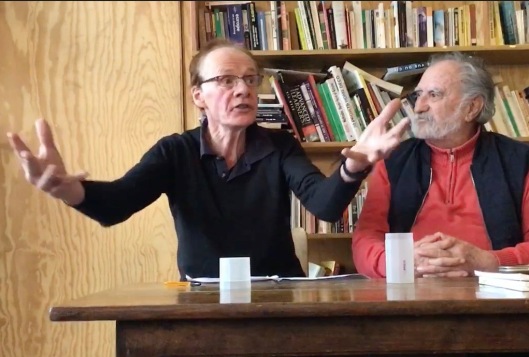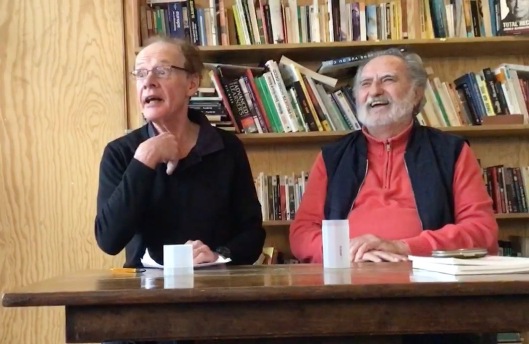Étiquettes
 Ninetto Davoli et Totò en « Uccellacci et uccellini » de Pier Paolo Pasolini
Ninetto Davoli et Totò en « Uccellacci et uccellini » de Pier Paolo Pasolini
Ce vendredi 21 juin, les Poètes sans frontières ont lancé une chaîne poétique sur le thème de la PAIX.
Les amis et les sympathisants de Poètes sans frontières ont été invités à consacrer une minute dans la journée à la lecture à voix haute d’un poème ayant pour sujet la Paix.
Pour participer moi aussi à cette initiative à la fois solennelle et solidaire, j’ai invité mes amis de Twitter à m’envoyer une citation de leur choix sur le thème de la Paix, ou alors une poésie d’eux-mêmes, qu’au fur et à mesure je vais insérer ci-dessous.
Et voilà ma contribution : le texte d’une chanson au sujet de la guerre écrite par Italo Calvino en 1958 :
Où s’envole-t-il le vautour ?
Un jour dans le monde, la dernière guerre se termina,
le sombre canon se tut et ne tira plus,
alors que, depuis la terre aride,
en manque de son affreuse nourriture,
un troupeau de vautours noirs se leva.
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma terre à moi :
c’est la terre de l’amour.
Le vautour chercha le fleuve
et le fleuve lui dit : « Non !
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en !
Dans le limpide courant,
on ne voit, maintenant,
que les carpes et les truites,
ils ne sont plus là les corps des soldats
qui le font saigner ».
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma terre à moi :
c’est la terre de l’amour.
Le vautour chercha la forêt,
mais la forêt lui dit : « Non !
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en !
Parmi les feuilles, au milieu des branches,
seuls les rayons de soleil passent,
les écureuils et les grenouilles,
et l’on ne veut plus des coups du fusil ».
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma terre à moi :
c’est la terre de l’amour.
Le vautour bondit sur l’écho,
l’écho aussi lui dit : « Non ‘
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en !
Je ne porte que les chants,
les bruits sourds des sapes,
les rondes et les berceuses,
je n’en veux plus du grondement du canon ».
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma terre à moi :
c’est la terre de l’amour.
Le vautour s’en alla chez les Allemands,
les Allemands lui dirent : « Non !
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en !
Nous ne voulons plus manger de la boue,
de la haine et du plomb dans les guerres,
du pain et des maisons dans la terre d’autrui,
nous ne voulons plus voler ».
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma terre à moi : c’est la terre de l’amour.
Le vautour s’en alla chez la mère
et la mère lui dit : « Non !
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en !
Mes enfants je ne les donne
qu’à une belle fiancée
qui les emmène dans son lit,
je ne les envoie pas tuer ! »
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma terre à moi :
c’est la terre de l’amour.
Le vautour chercha l’uranium
et l’uranium lui dit : « Non !
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en !
Ma force nucléaire
nous amènera sur la Lune,
elle n’explosera pas, brûlante,
en détruisant les villes ».
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma terre à moi :
c’est la terre de l’amour.
Mais ceux qui regrettaient les guerres, ce jour-là,
dans un lieu déserté pour comploter se rassemblèrent.
Ils virent ce troupeau arriver, voltigeant, du ciel,
et descendre, descendre avant que quelqu’un s’écriât :
Où s’envole-t-il le vautour ?
Vole ailleurs, vautour,
vole-t’en de ma tête à moi :
mais le rapace les dévora.
Italo Calvino, Dove vola l’avvoltoio ? (Trad. Giovanni Merloni)
Giovanni Merloni, La menace, pastel sur papier, 1970
Une seule strophe pour la paix
J’avais un revolver. L’elfe s’intéressa :
» Quel est cet os coudé qui dans ta main scintille ?
– Quand j’ai raison, je tire et l’autre décanille.
– Si tu as tort ? – Je tire ! » Et, voltant, me laissa.
Noël Bernard
Paix à celui qui hurle parce qu’il voit clair
Paix à nos esprits malades, à nos coeurs éclatés
Paix à nos membres fatigués, déchirés
Paix à nos générations dégénérées
Paix aux grandes confusions de la misère
Paix à celui qui cherche en se frappant la tête contre les
murs de béton
Paix au courroux de l’homme qui a faim
Paix à l’enfant qui vient de naître
Paix à la haine, à la rage des opprimés
Paix à celui qui travaille de ses mains
Paix à cette nature qui nous a toujours donné le meilleur
d’elle-même
et dont chaque homme quel qu’il soit a besoin
Paix à nos ventres, grands réservoirs de poubelles
académiques
Paix à vous mes amis, dont la tendresse m’est une
nécessité
Paix et respect de la vie de chacun
Paix à la fascination du feu, paix au lever du jour, à la
tombée de la nuit
Paix à celui qui marche sur les routes jusqu’aux horizons
sans fin
Paix au cheval de labours
Paix aux âmes mal-nées qui enfantent des cauchemars
Paix aux rivières, aux mers, aux océans
qui accouchent de poissons luisants de gas-oil
Paix à toi ma mère, dont me sourire douloureux s’efface
auprès de tes enfants
Paix enfin à celui qui n’est plus et qui toute sa vie
a trimé attendant des jours meilleurs
PAIX…
PAIX…
PAIX…
Catherine Ribeiro + Alpes, par Marie-Noëlle Bertrand
C’est la récolte et sur les doigts, fleurit un réseau écarlate. On l’aspire, sans trop penser. Des billes rouges, et des filins, qui se relient et qu’on avale. Ne gâchons pas. Et l’on retourne à la moisson, un nouveau ruisseau à l’index. Déjà réapparu. Encore du rouge et l’on recycle, et l’on avale, et il reviendra dans les veines.
Oui, mais on cueille.
N’importe quel serpent se mordrait bien la main, si il en avait une.
Voilà le champ vidé, nous en voilà des tonnes, et nous voilà comptable. Et tout bien réfléchi, nous aurions préféré en calculer moins long.
Si nous n’avions pas tant fourni d’engrais à nos chardons.
François Bonneau
Le soir
on croise les jambes
on fume
on regarde les oiseaux
qui plongent vers le haut
dans la lumière.
Thomas Vinau, La trève
par Brigitte Célérier
«Effacez dans les flots vos couleurs meurtrières.
Les roseaux sont nombreux et le roc est épais ;
Chacun en peut tirer sa pipe. Plus de guerres,
Plus de sang ! Désormais vivez comme des frères,
Et tous, unis, fumez le Calumet de Paix !»
Charles Baudelaire, par Élisabeth Chamontin
J’attends la fuite des vents
à la renverse
paix sur les noyés et les goémons
paix sur les îles et les quais
mon cœur
tranquille caboulot
à la bonne brise
au-dessus des limons
affiche son enseigne
« Au repos du marin »
Xavier Grall par Claudine Chapuis
un désir d’union
oh ! ce désir d’union
fluide, fertile
double du double
double du redoublement
pétales ouverts
pétales sans fin, parfumés du parfum de l’indicible
la fleur du perpétuel
fontaines
le pouls de la fenêtre s’éveille
le pouls lumineux du point du jour
éblouissant
Henri Michaux – Paix dans les brisements
par Clotilde Daubert
C’est un matin très sombre, au dehors il fait noir.
Par ce temps j’ai besoin d’un grand café bien noir
Je t’apporte un bon thé au lit, si t’es pas contre
Mon pied, le pied du lit : douleur de la rencontre
Guy Deflaux, 10.12.2011
Entendu il y a un long temps dans une allée d’un hypermarché:
« Ce n’est pas tant pour les autres que l’on pardonne que pour soi. »
José Defrançois
« Sur les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom »
Paul Eluard
par Marie-Christine Grimard
La paix, objet de ma quête nocturne !
Fenêtre fermée contre voisin fêtard,
Tout petits écouteurs,
Un bel album du Zawinul Syndicate,
Fondu au noir.
Claire Grivet
Trouver enfin la paix qui douce y pleut…
Y pleut des voiles du matin sur le chant des grillons
Là-bas, où minuit n’est qu’étincelles, midi pourpres lueurs
Et le soir nuées de vols de lingots…
W.B. Yeats, the Lake Isle of Innisfree: …
par Claire Grivet
« Art des jours art des nuits
La balance des blessures qui s’appelle Pardonne
Balance rouge et sensible au poids d’un vol d’oiseau
Quand les écuyères au col de neige les mains vides
Poussent leurs chars de vapeur sur les prés
Cette balance sans cesse affolée je la vois
Je vois l’ibis aux belles manières
Qui revient de l’étang lacé dans mon cœur
Les roues du rêve charment les splendides ornières
Qui se lèvent très haut sur les coquilles de leurs robes
Et l’étonnement bondit de-ci de là sur la mer
Partez ma chère aurore n’oubliez rien de ma vie
Prenez ces roses qui grimpent au puits des miroirs
Prenez les battements de tous les cils
Prenez jusqu’aux fils qui soutiennent les pas des danseurs de corde et des gouttes d’eau
Art des jours art des nuits (…) »
André Breton, Clair de terre, « Non-lieu » (Poésie/Gallimard; 1966, page 109)
par Dominique Hasselmann
La plus jolie prière
Le regard innocent
Du tout-petit enfant
Lui ne veut ni la guerre
Ni la peur, ni le sang
Mais l’amour de sa mère
Et la paix sur la terre.
Josette Hersent
pas facile
de placer des mots
entre la lumière qui tombe
et puis la peur qui vient
on ne sait d’où au point
de devoir prendre l’air
qui manque
Antoine Emaz Os Editions Tarabuste
par Élise Lamiscarre
«Car ces cœurs qui haïssaient la guerre
battaient pour la liberté au rythme même
des saisons et des marées,
du jour et de la nuit.
Robert Desnos 1943
par Laurence Lebel
Double éclair. Des champignons surgirent autour de la montagne où l’ermite avait fui, loin des irrécupérables, trop près encore de sa faiblesse pour se reposer. Les champignons croissaient en accéléré, leurs spores en crinière léonine virant de l’orange au blanc. Enfin, la paix.
Marc Mahé Pestka
si vis pacem para bellum
ses vices parsèment bel homme
si tu veux la paix prépare la guerre
sicut vela parentes alas agerent
(approche fantassine fantaisiste)
Noëlle Rollet
Avec des mots très simples
Sans fard et sans tics
De langage
Tout enrobés au lait
De la tendresse humaine
Le poète s’écrie :
Allez en Paix !
Francis Vladimir