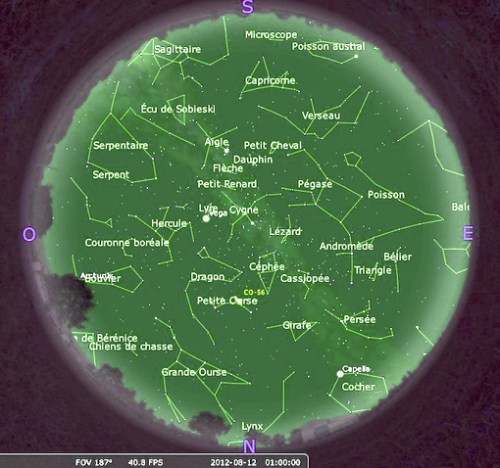(E.Ascione, I.Insolera « Monti d’Italia, l’Appennino settentrionale », ENI 1974)
Petite digression sur l’infini/2
Chère Catherine,
Tu ne finis pas de me surprendre ! Avant-hier, je te peignais malade ou convalescente… et hier tu m’as appelé pour avoir de mes nouvelles… Cela me comble derechef de joie et de confiance. Nous pouvons reprendre le chemin bras dessus, bras dessous. Et tu me donnes le courage de m’aventurer dans la citation d’une des « lettres de Jacopo Ortis » de Ugo Foscolo, la 35ème, sur le thème de l’infini.
Elle est très intéressante, non seulement parce qu’on y peut reconnaître une série d’éléments que Leopardi a ensuite exploités à l’intérieur de sa conception originale de l’expression littéraire, mais aussi comme document de la naissante littérature romantique en Italie, révélant beaucoup de points de contacts avec la littérature européenne contemporaine (on connaît le penchant de Foscolo pour l’Anglais Laurence Sterne de L’Éducation sentimentale, qu’il avait traduit en italien ; tout le monde est d’ailleurs informé de l’évident lien entre l’Ortis et le Werther de Wolfgang Goethe. Mais je voudrais aussi approfondir, un jour, l’examen, que j’avais entamé, des influences réciproques entre Foscolo et la France, Stendhal en particulier).
J’y reviendrai, pour examiner aussi la contradiction apparente entre une certaine « continuité » entre Foscolo et Leopardi tandis qu’ils ont conduit deux vies qu’on ne pourrait imaginer plus éloignées, pas seulement en raison des différents lieux et contextes traversés par chacun d’eux…
Pour le moment, aujourd’hui, je me borne à cette magistrale peinture poétique d’un typique paysage italien, en essayant de faire passer, au cours de sa lecture et relecture, des images cohérentes…
(E.Ascione, I.Insolera « Monti d’Italia, l’Appennino settentrionale », ENI 1974)
Colli Euganei, 13 mai 1798
« Si j’étais peintre ! Quelle riche matière pour mon pinceau ! Se plongeant dans l’idée délicieuse du beau, l’artiste endormit ou du moins mitige les autres passions. Mais, si je fus un peintre, qu’aurais-je fait ? J’ai vu chez les peintres et les poètes la belle nature, et parfois la sincère nature aussi ; mais la nature suprême, immense, inimitable, je ne l’ai jamais vue dans un tableau. Homère, Dante et Shakespeare, trois maîtres majeurs parmi toutes les intelligences surhumaines, ont envahi mon imagination enflammant mon cœur : j’ai baigné leurs vers de larmes assez chaudes ; et j’ai adoré leurs ombres divines comme si je les voyais assises sur les voûtes sublimes au-dessus de l’univers, en train de dominer l’éternité. Même les originaux qui sont devant moi comblent tellement les énergies de mon âme, que je n’oserais pas, Lorenzo, en tirer les premières lignes, même si Michel-Ange en personne se dissolvait en moi. Grand Dieu ! Lorsque tu contemples un soir de printemps, est-ce que tu te réjouis de ta propre création ? Tu as déversé sur moi pour me consoler une source inépuisable de plaisir, que j’ai regardée souvent avec indifférence. Au sommet du mont inondé par les rayons pacifiques du Soleil qui va manquer, je me vois entouré par une chaîne de collines où les moissons ondoient et les festons des vignes s’agitent ne faisant qu’un avec les ormeaux et les oliviers : au loin, les escarpements et les cols semblent monter les uns sur les autres. Au-dessous de moi, les côtes du mont sont brisées en gouffres inféconds où l’on voit s’estomper les ombres du soir, avant de s’élever peu à peu ; le fond obscur et horrible ressemble à la bouche d’un abîme. Sur le flanc de midi, l’air est soumis au bois qui domine et assombrit la vallée où les troupeaux paissent et l’on voit des chèvres égarées se pencher vers le versant. Les oiseaux chantent faiblement, comme s’ils pleuraient le jour qui meurt, les génisses mugissent, et le vent semble s’amuser en susurrant parmi les frondes. Mais, du septentrion les collines se séparent, et s’ouvre à la vue une plaine interminable. On y discerne, dans les champs plus proches, les bœufs qui rentrent à l’étable : l’agriculteur las les poursuit s’appuyant sur sa canne ; et tandis que les mères et les épouses mettent la table pour le dîner de la famille fatiguée, on voit fumer au loin les maisons encore blanches, et les cabanes éparpillées dans la campagne. Les bergers traient les brebis, et la petite vieille cesse de filer près de la porte du bercail, abandonne son travail pour caresser et frotter, maintenant, le jeune taureau et les agneaux qui bèlent près de leurs mères. Entre-temps, la vue se dilue au-delà d’interminables enfilades d’arbres et de champs, avant de s’achever dans l’horizon où tout s’amoindrit et se confond. Le soleil, en partant, lance juste quelques rayons, comme d’extrêmes adieux qu’il concède à la Nature ; et les nuages rougissent, puis deviennent pâles et languissants avant de s’assombrir. À ce moment-là, la plaine se perd et les ombres se répandent sur la face de la terre. Et moi, qui me trouve presque au milieu de l’océan, je ne trouve de ce côté-là que du ciel. »
(« Dernières lettres de Jacopo Ortis », Ugo Foscolo. Milan 1802. Lettre XXXV)
(E.Ascione, I.Insolera « Monti d’Italia, l’Appennino settentrionale », ENI 1974)
Chère Catherine,
Hier, tu me demandais qui était-ce la dame à l’air débonnaire et gentil qui se trouvait à Recanati avec ma mère, mes frères et moi. C’était Dora, une des cousines de Cesena (et Sogliano) auxquelles, comme on peut bien le voir, on y était tous très attachés…
Tu as reconnu tout de suite le mur avec le premier vers de l’Infini :
SEMPRE CARO MI FU QUEST’ERMO COLLE
Pourtant tu as ressenti une certaine tristesse, sinon angoisse. Je ne sais pas. Mon souvenir de cette escapade — Recanati n’est pas si loin de Cesena, ou bien nous y étions passés sur la route du retour à Rome, et Dora devait par la suite passer quelques jours chez nous —, est surtout lié au souvenir du fauteuil où le jeune poète passait des journées entières sans autre distraction que la lecture… Je me souviens d’une petite table, d’un petit cahier avec ses poésies plus célèbres :
« Passée est la tempête,
J’entends les oiseaux faire fête… »
 Photo : Collection Frères Merloni. Reproduction interdite
Photo : Collection Frères Merloni. Reproduction interdite
Voilà, Catherine, nous étions tous fort pénétrés de cette grandeur que les communs des mortels n’atteignent pas. Et ma mère nous racontait le sentiment de l’infini, tandis que Dora nous expliquait le paysage, qui d’ailleurs a beaucoup de points en commun avec celui de la Romagne.
Mon père conduisait magistralement la petite voiture où surtout ma mère et Dora peinaient beaucoup à trouver une position confortable… et nous immortalisait dans ces lieux immortels.
Il parlait très peu, sauf si quelques discussions politiques ou pour ainsi dire « philosophiques » se déclenchaient dans les réunions avec parents et amis.
Il nous transmis bien sûr une grande affection pour son père Zvanì, mais il en raconta toujours très peu, probablement pour décourager tout tentative d’en savoir plus.
(Je n’ouvre pas ici la parenthèse pour exploiter une question qui me revient souvent. Je me borne à l’énoncer : pourquoi mes parents ont mis toute leur force, enthousiasme et finesse d’esprit pour nous faire aimer des personnes et des lieux dont ils n’avaient aucune envie de parler ?)
Cela dit, je me rappelle maintenant la raison de notre air sérieux et légèrement troublé ce jour-là. Mon père, avant d’actionner l’appareil photo, nous avait provoqués :
— Avez-vous réfléchi à l’importance d’une haie, d’un parapet ou d’une balustrade quelconque lorsqu’on se mesure avec l’infini ?
Edward Hopper (catalogue)
Giovanni Merloni
écrit ou proposé par : Giovanni Merloni Première publication et Dernière modification 24 février 2013.
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 3.0 non transposé.