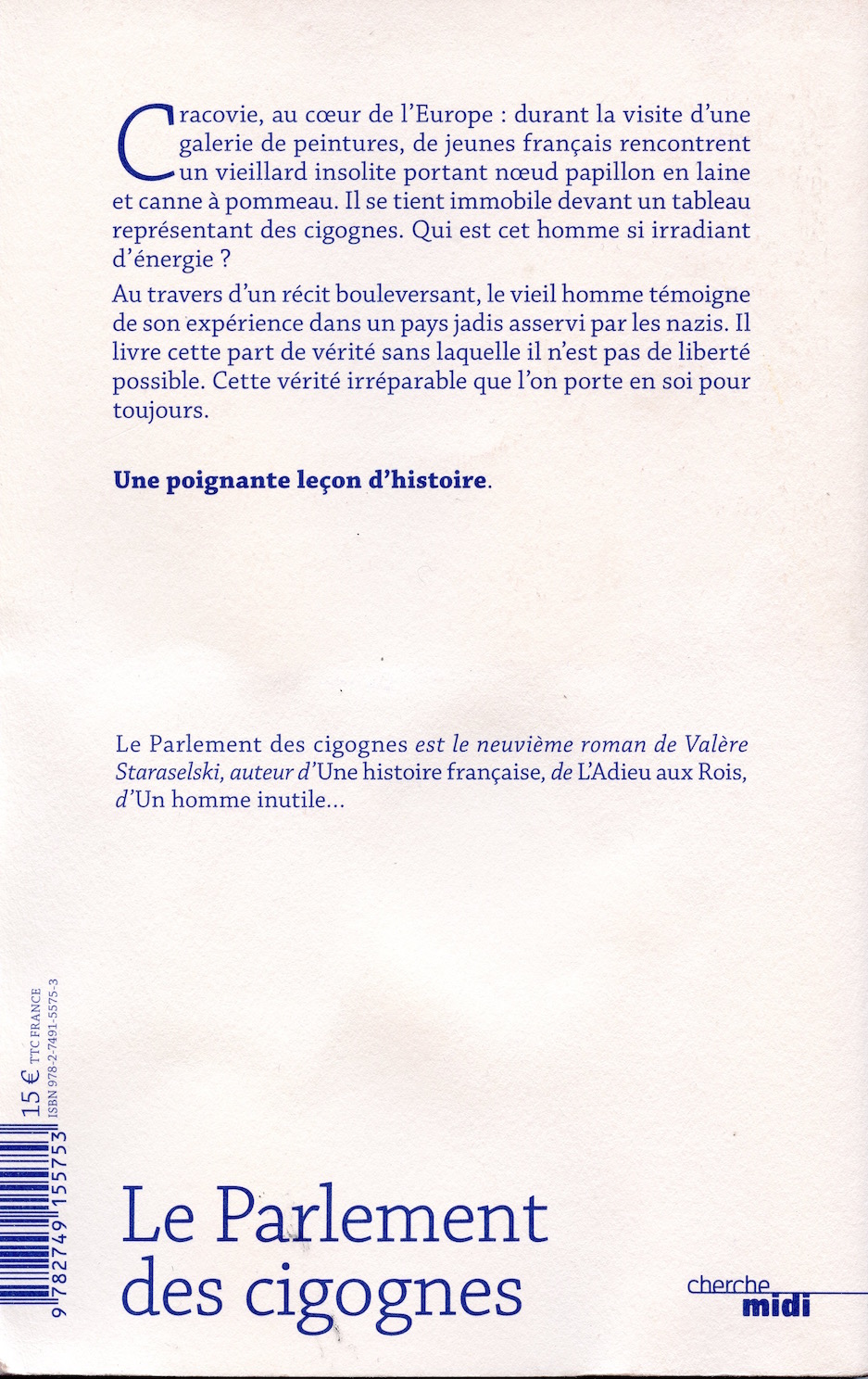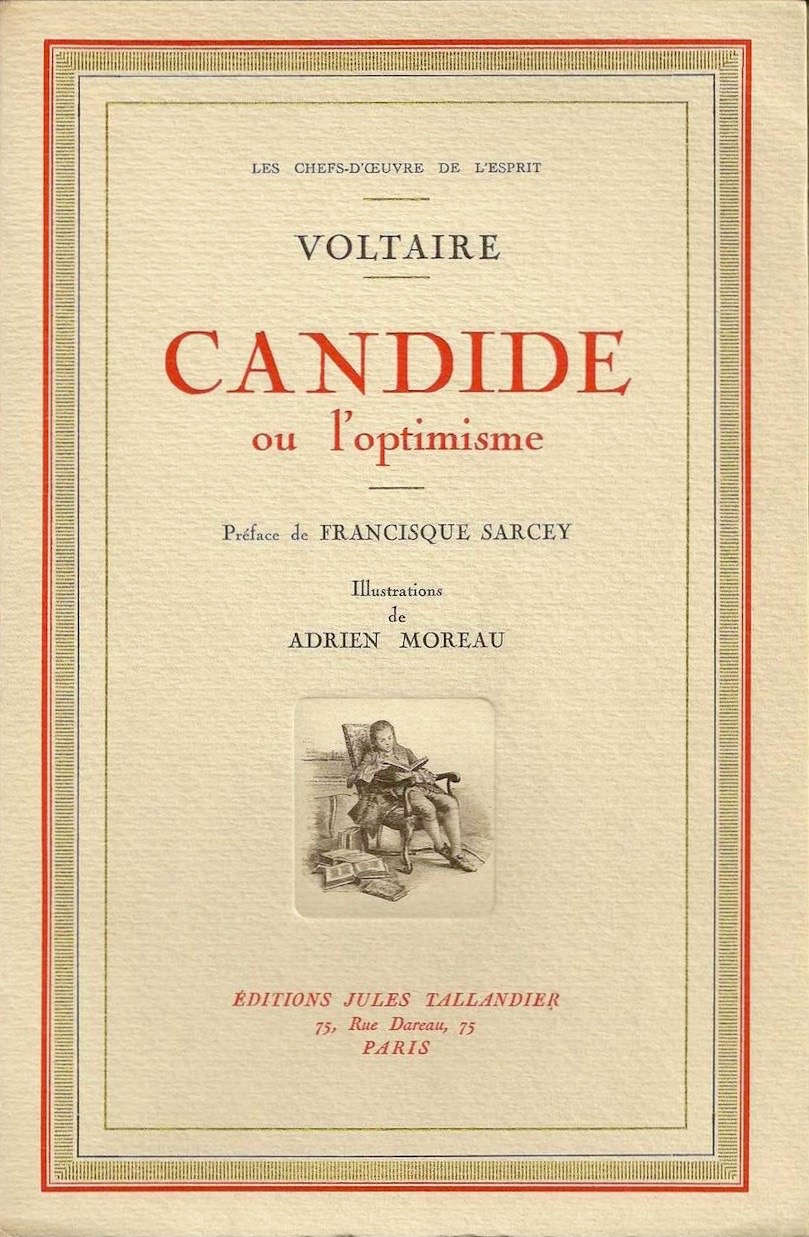Étiquettes
Je viens de terminer la lecture du dernier roman de Valère Staraselski — “Les passagers de la Cathédrale” (Le cherche midi, 2025) —, que j’ai beaucoup aimé.
Au commencement, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose en moi qui m’empêchait de m’y plonger dedans. C’était à cause de la scène de vent impossible de novembre 2017, que j’avais lu un peu à la hâte, sans trop la comprendre. Ensuite, j’ai retrouvé mes repères et, en fin de lecture, j’ai constaté combien était-elle importante, dans l’ensemble du roman, cette scène-là qui, tout en donnant le ton et le « la », contenait déjà, en germe, telle l’ouverture d’un opéra, la plupart des thèmes posés et fouillés à fond dans les pages qui la suivent.
En fait, en relisant le premier chapitre après avoir lu et apprécié les autres, j’ai compris la fonction narrative et philosophique que V. Staraselski assigne à la cathédrale : qu’il s’agisse de la moins connue Saint-Étienne de Meaux ou de l’hyper mondialisée Notre Dame de Paris, la cathédrale symbolise (tout comme les autres innombrables consœurs de France et d’Europe) la force de l’histoire et la preuve de quoi les hommes sont capables, avec leurs talents et volontés réunies.
Tout au long du récit – ou pour mieux dire de deux récits parallèles se déroulant sous la forme de la conversation et/ou de l’entrevue – le thème de la religion, et notamment de la religion chrétienne (ayant eu un rôle central dans la naissance des nations européennes et de la nation française en particulier), constitue le fil conducteur d’un long raisonnement, qui finalement résonne dans la tête du lecteur, moins comme une évidence que comme une piste qui vaut la peine d’emprunter, d’abord pour comprendre, ensuite pour agir.
D’ailleurs, la cathédrale n’est pas que le symbole et la preuve de l’existence de Dieu. Elle a toujours été un grand espace vide qui attend d’être rempli… par la foi, c’est-à-dire par un acte non obligatoire qui seul peut justifier la véritable sortie de l’homme de son « en soi » pour donner sa propre contribution active à la construction et à la défense d’une société égalitaire, fraternelle et solidaire…
En les aidant à refouler la frustration du manque (inévitable) de la réponse de Dieu, en les incitant énergiquement à donner eux-mêmes cette réponse, la foi pousse les hommes à se dépasser et agir au-delà de leurs limites. Sans une foi pareille, on ne pourrait pas expliquer l’immense abnégation de ceux qui ont fait les cathédrales, les ont défendues, réparées, embellies et remplies surtout d’une constante mission de partage, d’assistance et d’élévation sociale. Au nom d’une religion qui, malgré son histoire intermittente et tourmentée, se veut à juste titre très ouverte à la multiplicité des voix et des échanges.
Cela dit, « Les passagers de la Cathédrale » s’ouvre sur une situation qui, par la métaphore du vent, dit le contraire. Il s’agit aussi, bien sûr, d’un phénomène prémoniteur de la dévastation planétaire annoncée : la nature est en train de se révolter, essayant de nous avertir du pire qui va arriver. Mais je crois qu’ici la signification est plus vaste et profonde : il s’agit d’une sorte de parabole : François Koseltzov, pas du tout habitué à fréquenter les églises, échoue sur la nécessité absolue d’y entrer à cause du vent, en train de le rendre fou. Mais l’horaire d’ouverture est dépassé, l’immense porte de la cathédrale est fermée !
Cependant, en échange, cette journée exceptionnelle lui fait rencontrer cet homme, Louis Massardier, qui est lui-même une cathédrale, une cathédrale où la porte est ouverte. Plus tard, il découvrira qu’il suffit d’avoir la bonne clé pour entrer dans l’église et profiter de son calme silencieux pour en découvrir les trésors.
Ce jour de tempête, François a donc saisi un manque, il a découvert un besoin en lui, et commencé à entrevoir un but et peut-être un parcours pour arriver à le satisfaire. Il va d’abord exaucer son anxiété subliminale de voir ce qui se passe là-dedans… Et c’est ainsi qu’un athée endurci peut devenir “passager de la cathédrale” !
Cet athée endurci est bien sûr un homme des années deux mille, tiraillé comme jamais par la nécessité d’empêcher qu’on jette à la poubelle l’immense héritage des générations qui le précèdent et la tragique sensation d’une précarité contemporaine galopante, qu’un impressionnant manque de valeurs partagées ne fait qu’aggraver.
En fait, il ne faut absolument pas, comme le dit un ancien proverbe, « jeter le nouveau-né avec l’eau sale ». Il est plus sage d’essayer de renouer avec tout ce que le genre humain, au fil des siècles, a fait de positif, de sain et de respectueux envers la nature et lui-même.
D’autant plus qu’il y a beaucoup de choses qui résistent, demeurant figées dans les traditions et dans les convictions de tout un chacun : les religions, par exemple, l’idéal communiste, l’idée de démocratie républicaine, la laïcité, l’antifascisme, et bien sûr l’immense patrimoine d’expériences, de luttes, de vies exemplaires, dont on connaît le sacrifice, l’héroïsme, la génialité, le charisme, et cætera.
Quitte à découvrir, au fur et à mesure, le fond de grande humanité et sensibilité demeurant en tous les cinq personnages ainsi que dans l’esprit et l’âme de son Auteur, celui-ci facilite la lecture et l’administration des émotions de tout un chacun :
— se donnant la contrainte de laisser s’écouler deux récits parallèles aux différentes densités narratives, s’intégrant parfaitement entre eux, qui se déroulent l’un en août 2017 et l’autre de novembre 2017 jusqu’à la Noël 2018 ;
— choisissant pour décors de son « voyage hors du temps » des endroits ayant une grande force symbolique : la Cathédrale de Meaux, le Jardin Bossuet, l’Institut médico-légal de Paris, le Carré des Indigents au cimetière de Thiais, la maison de Louis Massardier avec ses « dazibaos » ;
— confiant le rôle de « moutons désemparés à la recherche de la lumière » à François Koseltzov et à ses deux amis fraternels (l’Iranien persécuté Darius Madhavi, musulman chiite et le Français Thierry Roy mieux connu comme Chéri-Bibi, fervent catholique), partageant avec lui une primordiale blessure ainsi qu’une vie constellée de difficultés très dures à supporter ;
— accordant une irremplaçable fonction stratégique à la jeune femme Katiusca Ferrier, se révélant au fur et à mesure un véritable « don du ciel » ;
— plaçant au centre de toutes les convoitises Louis Massardier, l’ancien « militant emmerdeur », celui dont personne ne voulait plus entendre les raisons, qui se révèlent pourtant précieuses et d’impressionnante actualité.
Pendant un temps inoubliable, les jeunes gens désemparés trouvent donc en Louis leur « maître de vie », leur Ange gardien avec une renouvelée raison de croire en quelque chose de positif pour le futur.
De son côté, la reconnaissance de Louis est également vive et profonde : « Vieillir, en fait ça revient à être peu à peu fichu en dehors de l’existence. Les portes, en quelque sorte, ne s’ouvrent plus. Elles demeurent closes. Là, avec lui [François], la porte était déjà ouverte ! Et elle est restée grande ouverte. Ça, si je n’étais pas tombé sur lui ce jour de tempête, mon penchant Alceste, se serait encore accentué. Et l’aurait emporté. […] Cela dit, il est vrai, enfin j’avoue, j’ai de plus en plus de mal avec mes congénères. C’est que je n’ai plus vraiment le temps, plus la force. Heureusement, il y en a parmi eux qui sont dotés d’une conscience active ! Katiuscia, oh que cette gamine est formidable de vie ! Elle n’a pas froid aux yeux, la môme. Elle bataille. » (Page 153)
« Les passagers de la cathédrale » m’a beaucoup touché et intrigué par son honnêteté intellectuelle et son approche poétique discret et réfléchi ainsi que pour le courage d’assumer une « thèse » à la fois morale et politique, apparemment paradoxale et provocatrice et parfois problématique, qui répond pourtant très correctement à la plupart des questions qui flottent aujourd’hui sans réponse au-dessus de nos têtes.
Un livre à la portée de tous, qui coule avec élégance et dans le respect des temps de l’attention. On dirait que V. Staraselski a parfois décidé de « ralentir » son exposition pour attendre les retardataires, comme moi, en leur donnant le temps de récupérer les passages perdus ou mal compris.
En relisant à plusieurs reprises certains passages, qui deviennent enfin familiers, j’ai eu même la sensation de la perfection, car ici rien ne manque pour faire vivre les multiples facettes de la « polis » souhaitée, l’endroit accueillant où vont se former les idées, les contrats, les alliances et l’on pourra apprendre à considérer la valeur fondatrice de l’altérité, de la reconnaissance à Dieu ainsi qu’à tout ce qui lui appartient.
Comme le dit Louis Massardier, Dieu est un tout, « Un tout constitué de deux. Comme l’identité. Oui, cela, s’était en quelque sorte créé : l’émergence du sujet, la possibilité d’un sujet, lorsqu’il avait pu y avoir va-et-vient, dialogue, rapport, relation, résonance… Ce qui induisait qu’il n’y avait pas de Moi sans Toi et que le Je ne pouvait pas être sans le Nous. Et le Nous inconcevable sans le Je… Et que l’autre se soit d’abord appelé « Dieu » ne changeait rien à l’affaire ! » (Page 211)
Cette « perfection » qui ne prétend pas du tout de l’être, est d’ailleurs le réflexe de la situation profondément dégradée de l’information contemporaine, de plus en plus stricte et mensongère et désormais totalitaire, obligeant les intellectuels militants ainsi que les écrivains à ne rien négliger pour ne pas être mal interprétés voire soumis au plus sommaire des jugements.
C’est surtout dans ce dernier roman que cette exigence devient systématique. Escomptant l’époque actuelle, où le dialogue et la compréhension entre les humains sont devenus de plus en plus rares et difficiles, l’Auteur voit justement la nécessité d’offrir au lecteur un contexte ainsi qu’un temps adapté.
En fonction de cela son choix est net : loin de Paris, de ses sirènes et de cyclistes impitoyables. Et c’est donc à Meaux, dans un univers connu et paisible que l’Auteur, maître de « l’art de la conversation », invite une petite communauté homogène et disparate à la fois, qui anime le débat et, en même temps, témoigne, par sa « présence militante », de la possibilité concrète de faire front à la complexité.
Au cours de la lecture, cette dialectique entre la ville capitale et la petite ville traversée par la Marne et le canal de l’Ourcq se révèlera essentielle, tout comme important au point de vue symbolique est le lien — d’abord subliminal et enfin explicite — entre la cathédrale Saint-Étienne et Notre Dame de Paris, la grande blessée. Car en fait l’attitude de tous les personnages du roman envers Paris ressent toujours d’un sentiment contradictoire, pleinement justifié : d’un côté une forme de gêne sinon de rejet vis-à-vis de la vie dure et difficile qu’on y doit subir, de l’autre l’intarissable émerveillement face aux trésors de beauté et de vitalité positive que cette ville contient.
Le choix des endroits, ne faisant qu’un avec l’invention-découverte de personnages dignes d’un grand réalisateur français, se marie parfaitement à cette nécessité de fouiller ensemble dans la dure réalité pour en extraire quelques vérités à assumer… collectivement.
C’est quelque chose que tout être humain a vécu au moins une fois dans sa vie : ce moment magique où se forme une petite communauté d’égaux qui deviennent amis au fur et à mesure qu’ils se disputent sur ce qui leur tient plus vivement à cœur ou lorsqu’ils découvrent, ensemble, une chose inattendue qui peut tout changer de leurs convictions… En même temps, par le biais de ce « faire ensemble » ils s’ouvrent réciproquement le cœur, ils deviennent solidaires.
Mais ce livre « magistral » jaillit surtout de la rencontre entre François Koseltzov et Louis Massardier (dont le prénom est sans doute celui de Louis Aragon, tandis que le nom semble emprunté à Hugo ou à Balzac) et se structure autour d’elle. Seul personnage toujours présent sur scène, le jeune François n’a pas hâte de se laisser découvrir par le lecteur, car il peine beaucoup à gérer sa souffrance psychologique ainsi que sa détresse physique et morale. Tout en ayant besoin d’être rassuré et autorisé à vivre, il est pourtant amené, par sa vive intelligence et son esprit généreux, à la découverte de nouveaux défis. Au-delà de ses rares monologues silencieux, où il dévoile, parfois brusquement, son ressenti, ses interventions sont toujours brèves et ciblées. Le lecteur ne connaîtra qu’à la fin (pages 233-236) son esprit et son âme nobles.
Heureusement, quelques mois avant de connaître Louis, François avait rencontré une certaine Katiuscia qui, dès son apparition à Meaux, donnera à toute la compagnie d’amis une touche de véritable bonheur. Pour François, l’expérience extraordinaire et inespérée de l’échange intergénérationnel avec Louis sera la cerise sur la tarte de son équilibre personnel que la présence de Katiuscia à ses côtés est déjà en train de renforcer.
Inébranlable centre de gravité, avec son humour et sa désarmante sincérité, Louis Massardier rend le lecteur heureux d’être là à son écoute, même s’il comprend que celui-ci est en train de profiter de ses derniers moments de vie pour distiller son sang même. Suivant ses connaissances et sa longue expérience, le vieux Louis traîne ses partenaires dans des discours tous azimuts qui se révèlent toutefois bien ancrés :
« Lui qui, tout au long de son existence, avait été un être de conviction ! Conviction, pas certitude… Et Dieu sait qu’il y en avait, des êtres à certitude ! Lui qui avait choisi d’endosser la réalité, de prendre parti, d’être, de devenir, oui, un militant. Et puis qui avait cessé faute d’organisation, faute de contenu, faute des combattants. Faute non de raison d’être, mais d’orientation à force de baisser pavillon. À court de liens avec la réalité parce que plus d’”orga” comme on disait, digne de ce nom. Oui, l’organisation qui ne semblait plus vivre que pour elle-même, ratatinée sur de faux militants de conviction mais vrais militants alimentaires. Organisation devenu appareil, qui avait un temps dérivé dans la communication pour la communication et, croyant se reprendre, avait opté pour la sous-culture des extrémistes. Ceux qui éternellement se satisfont de dire non… » (Pages 157-158)
Au bout d’une vie qu’on devine pleine et dense d’épreuves, cet ancien professeur d’histoire contemporaine au Collège de France essaie de dévider « pacifiquement » le nœud gordien contemporain au nom d’un souterrain espoir : que le communisme revienne, comme le christianisme, à son essence foncièrement religieuse. Ce que Gramsci appelait le “communisme au visage humain”, peut-être : une grande alliance de chaque peuple avec son histoire : un communisme intégré dans la démocratie républicaine, capable d’hégémonie mais aussi d’écoute et de respect des raisons d’autrui.
Le rôle stratégique de Katiuscia, vaguement annoncée dans les premiers « actes » du récit douloureux qui fait pendant à l’histoire principale, s’affiche pleinement dans le chapitre au titre « La semaine Sainte » (pages 99-113), extrêmement suggestif, au-delà de l’hommage à l’un des chefs-d’œuvre de Louis Aragon. Suggestif et allusif parce qu’entre le dimanche de Rameaux et celui de Pâques se déroule la plus grande révolution sémantique dans le mystère de la foi : la Résurrection du Fils de Dieu. Une résurrection privée celle que vit François lorsqu’il commence, avec Katiuscia, sa vraie vie ; une résurrection collective, celle prônée par Louis Massardier et ses camarades, qui n’arrivera que le jour où les hommes apprendront à se respecter les uns les autres.
Dans le récit « théatral » que François raconte à Darius sur le train qui les amène de Paris à Meaux, l’Amour subliminaire avec Katiuscia a le pouvoir de refouler l’idée de la Mort et du renoncement et de projeter le couple naissant vers la vie et le combat serein pour une existence digne et solidaire.
Dans l’histoire de notre cénacle contemporain, dont Louis Massardier, l’homme âgé, est le maître, c’est l’Amitié, qui établit, au fur et à mesure, un terrain commun — très proche du bien commun souhaité — entre personnes mûries par le biais de différentes expériences. L’ancienne Renault bien conservée qui emmène à Valmy-la-bataille quatre hommes soudés, peut évoquer chez le lecteur l’image du “radeau de la Méduse” où se rassemblaient les “copains d’abord” de George Brassens.
Je n’aurai pas mis en exergue l’Amitié et l’Amour si le thème de la Mort ne fût dominant tout au long du livre : d’abord, la mort évoquée de Brice Beaulieu, dont François Koseltzov ressent la responsabilité (parce qu’il n’avait pas eu la promptitude de l’empêcher en se chargeant jusqu’au bout de l’état extrêmement critique de son ami) ; ensuite la mort évoquée par le franco-iranien Darius Madhavi (ayant vu mourir à ses côtés l’un de ses camarades de prison) ; puis, la mort d’un pauvre chien, tué et mutilé par son même patron avant d’être jeté dans le canal de l’Ourcq près de Meaux ; enfin, les innombrables morts dans la rue… des morts intervenues précocement, avec violence, au milieu de vies difficiles sinon impossibles, se gravant indélébilement dans la peau et dans les nerfs de ceux qui les ont frôlées de près ou se sont donné le courage de les regarder en face tout en ayant un œil trop sensible.
Tous les personnages que V. Staraselski convie dans sa recherche d’une réponse unitaire et plurielle à notre embarras contemporain, ce sont des anciens militants, des vrais, qui ne trouvent plus, dans la réalité contemporaine, un véritable contexte de rencontre et d’action. C’est le signal clair d’un sentiment d’impuissance : malgré toutes les analyses systémiques, voire idéologiques, dont on pourrait se servir pour échafauder cette réponse sociale, culturelle, morale, mais surtout politique, en manque d’un véritable militantisme plein et désintéressé, tout espoir de « renaissance » des consciences apparaît illusoire. D’ailleurs, « il y en a toujours, des Justes, des êtres normaux dotés d’une colonne vertébrale morale et mentale ! » (Page 82)
Je ne peux que partager cette confiance dans ce Dieu que même les hommes justes ont perdu. Je pense que c’est le même Dieu dont avait besoin Jean-Jacques, le même Facteur lui inspirant ce Contrat social qui tant se rapproche de l’idée d’Alliance proposée dans ce livre.
Et, « puisque l’homme s’est montré bien incapable de s’y tenir par lui-même, de respecter le contrat ! Dieu surplombe, il transcende. Ouf, enfin une autorité indiscutable et surtout permanente. Mais pas une autorité toute-puissante, omnipotente, despotique, autoritariste en un mot, puisqu’elle ne vaut que si, côté humain, il y a un accord, contrat, pacte, alliance… Or, la liberté de ne pas y souscrire existe ! Et seuls les mortels sont en mesure de faire vivre ou non cela. Cet engagement, je veux dire. Car, fait majeur, la liberté est reconnue aux humains… » (Page 82)
Le travail que ce livre essaie de contenir et traduire est immense, prodigieux : on ne saurait que lire et relire ce texte bienveillant, sans avoir la moindre envie d’en contester l’honnêteté et la force morale. La lucidité aussi :
« Il faut agir, oui, être dans l’action et faire au quotidien comme si tout dépendait de nous. Car c’est bien là le secret : faire comme si absolument tout dépendait de nous et de nous seuls. Pas de salut hors de ça. » (Pages 50-51)
Giovanni Merloni