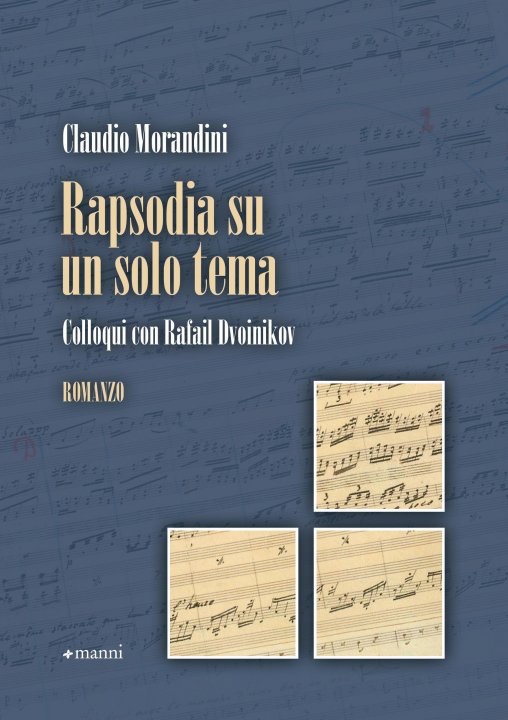L’art de la conversation dans la poésie de Jean de La Fontaine
…D’ailleurs, La Fontaine avait mille protections invisibles, qui venaient de ses deux amours. Les femmes, bien sûr, représentant pour lui un complément indispensable de son être en continuelle transformation. Les maîtres anciens, qui étaient eux aussi des « alter ego » dont il avait besoin pour avancer.
Les femmes sont ses Muses inspiratrices, capables elles seules de le plonger dans la rêverie et de faire éclater en lui la volonté d’aller au-delà, de dépasser lui-même :
Qu’un vain scrupule à ma flamme s’oppose
Je ne le puis souffrir aucunement,
Bien que chacun en murmure et nous glose ;
Et c’est assez pour perdre votre amant.
Si j’avais bruit de mauvais garnement,
Vous me pourriez bannir à juste cause ;
Ne l’ayant point, c’est sans nul fondement.
Qu’un vain scrupule à ma flamme s’oppose.
Que vous m’aimez, c’est pour moi lettre close ;
Voire on dirait que quelque changement
À m’alléguer ces raisons vous dispose :
Je ne le puis souffrir aucunement.
Bien miens pourrais vous conter mon tourment,
N’ayant pas mis au contrat cette clause ;
Toujours ferai l’amour ouvertement,
Bien que chacun en murmure et nous glose.
Ainsi s’aimer est plus doux qu’eau de rose :
Souffrez-le donc, Philis ; car, autrement,
Loin de vos yeux je vais faire une pose,
Et c’est assez pour perdre votre amant.
Pourriez-vous voir ce triste éloignement ?
De vos faveurs doublez plutôt la dose.
Amour ne veut tant de raisonnement :
Ce point d’honneur, ma foi, n’est autre chose
Qu’un vain scrupule.
(Jean de La Fontaine, Rondeau redoublé, 1671)
Les maîtres du passé l’accompagnent dans son parcours vers la gloire en lui fournissant des histoires, des petites phrases, et par elles le sens de la continuité, la valeur même de la culture.
Car il n’y a pas innovation sans un rapport fort et sincère avec la tradition. Chacun choisit ses repères, ses amis au milieu de milliers de voix « clamantes in deserto ». Virgile réécrit Omère en faisant un chef-d’œuvre immortel qui n’a plus rien à voir avec le poème de son maître, dont il garde pourtant l’esprit, le message éternel. Dante a besoin de Virgile pour parcourir ensemble ce voyage à rebours dans le passé lointain, où Virgile peut lui donner des renseignements utiles, et dans le passé voisin, où c’est Dante qui fait le guide à son guide. La Fontaine unit en lui l’esprit créateur du poète à l’esprit pragmatique de l’observateur de son temps et de tout ce qu’on lui offre, en particulier l’immense héritage de la culture grecque et latine. Il ne se borne pas aux plaisirs de l’invention poétique, mais se charge du passage du témoin du passé d’une rive à l’autre. En ramenant jusqu’au monde des vivants les œuvres des grands du monde des morts — car les anciennes langues grecque et latine sont de plus en plus réservées à une caste d’intellectuels très éloignés de la vie réelle —, il est bien conscient qu’avec lui une nouvelle langue française est en train de se former. Il en est le principal modernisateur. C’est cet aspect qu’on devrait regarder aujourd’hui avec une particulière attention. La Fontaine, en réécrivant de but en blanc beaucoup de textes anciens (par exemple Les amours de Psyché et de Cupidon, publié en 1669, tout de suite après les Fables de 1668), leur a donné une nouvelle vie. Ce que les traductions fidèles, mot par mot, ne réussissent jamais à faire.
D’ailleurs, pour avoir la grâce d’être accueilli, reconnu et finalement aimé, il faut aimer, aimer sans réserve. « Amor ch’a nullo amato amar perdona », dit Dante Alighieri : « tous ceux qui sont aimés, aiment à la fois ». Et La Fontaine aime sans réserve ses Muses inspiratrices aussi passionnément que ses œuvres immortelles, dont il devient, grâce à son amour sincère, le guide. Comme Dante recommandait Virgile, La Fontaine recommande Juvenal et Platon, Phèdre et Boccace.
C’est l’art de la conversation. C’est aussi l’anticipation du « contrappunto » en musique. La dialectique au service du plaisir de se plonger dans une histoire, qu’il soit prévu pour elle une chute de sagesse ou qu’il ne le soit pas. Une dialectique théâtrale, qui offre à tous ceux qui partagent l’évènement de l’interprétation du texte à haute voix, d’abord la consolation du rythme magique des mots, ensuite un primordial sentiment de partage. Une force se déclenche, qui n’est pas du tout soumise aux règles plus ou moins absolues que le pouvoir au dehors du théâtre impose. Et c’est la force d’une imagination sans préjugés et pleine d’anticipations vis-à-vis du procès de libération de l’homme qui va bientôt éclater.
De son temps, on a laissé à La Fontaine la gloire sans la lui reconnaître, on lui a laissé « molto onor, poco contante » comme à Chérubin partant à la guerre. Ceux qui se sont sentis obligés d’en abîmer la figure, comme Racine, avaient évidemment toujours peur que Jean de La Fontaine, après avoir été chassé en tant que poète de génie fût admis à la Cour pour son charme personnel. Et on a l’impression qu’il en avait même plus que les autres.
Giovanni Merloni

P.-S. Les écrivains parlent de La Fontaine
. Que pensent-ils de lui ?
(En allant, comme tout le monde, sur internet, j’ai trouvé des recueils de citations de grands hommes et d’hommes célèbres au sujet de La Fontaine homme et génie littéraire).
MAUCROIX (1619-1708) : « La Fontaine est un bon garçon,/ Qui n’y fait pas tant de façon./ Il ne l’a point fait par malice./ Belle paresse est tout son vice… »
MOLIERE (1622-1673): « Nos beaux esprits ont beau se trémousser, le Bonhomme ira plus loin que nous. »
Madame De Sévigné (1626-1696) : « Faites-vous envoyer promptement les fables de La Fontaine, elles sont divines. On croit d’abord en distinguer quelques unes, et à force de les relire, on les trouve toutes bonnes. C’est une manière de narrer et un style à quoi l’on ne s’accoutume point. »
Charles Perrault (1628-1703) : « Il n’a jamais dit que ce qu’il pensait, et il n’a jamais fait que ce qu’il a voulu faire. Il joignit à cela une humilité naturelle, dont on n’a guère vu d’exemple ; car il était fort humble sans être dévot, ni même régulier dans ses mœurs, si ce n’est à la fin de sa vie qui a été toute chrétienne. Il s’estimait peu, il souffrait aisément la mauvaise humeur de ses amis, il ne leur disait rien que d’obligeant, et ne se fâchait jamais, quoiqu’on lui dît des choses capables d’exciter la colère et l’indignation des plus modérés… Non seulement il a inventé le genre de poésie où il s’est appliqué, mais il l’a porté à sa dernière perfection. » (Charles Perrault, Les Hommes illustres qui ont paru en France)
Louis Racine (1634-1699) : « …Un homme fort malpropre et fort ennuyeux… Il ne mettait jamais rien du sien dans la conversation ; il ne parlait point ou voulait toujours parler de Platon, dont il avait fait une étude particulière dans la traduction latine. »
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) : « Les ouvrages de La Fontaine sont reçus avec des battements de mains. »
Jean de La Bruyère (1645-1696) : « Homme unique en son genre, modèle difficile à imiter ». « Un homme paraît grossier, lourd, stupide, il ne sait pas parler ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il se met à écrire, c’est le modèle des bons contes, il fait parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point: ce n’est que légèreté, qu’élégance, que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages. »
Fénelon (1651-1715) : « La Fontaine a donné une voix aux bêtes pour qu’elles fissent entendre aux hommes les leçons de la sagesse. »
Voltaire (1694-1778) : « C’est un homme unique dans les excellents morceaux qu’il nous a laissés (…) ils iront à la dernière postérité; ils conviennent à tous les hommes, à tous les âges. (…) Tous ces grands hommes furent connus et protégés de Louis XIV, excepté La Fontaine. Son extrême simplicité, poussée jusqu’à l’oubli de soi-même, l’écartait d’une cour qu’il ne cherchait pas; mais le duc de Bourgogne l’accueillit, et il reçut dans sa vieillesse quelques bienfaits de ce prince. Il était, malgré son génie, presque aussi simple que les héros de ses fables. Un prêtre de l’oratoire, nommé Pouget, se fit un grand mérite d’avoir traité cet homme de moeurs si innocentes, comme s’il eût parlé à la Brinvilliers et à la Voisin. Ses contes ne sont que ceux du Pogge, de l’Arioste, et de la reine de Navarre. Si la volupté est dangereuse, ce ne sont pas des plaisanteries qui inspirent cette volupté. On pourrait appliquer à La Fontaine son admirable fable des Animaux malades de la peste, qui s’accusent de leurs fautes: on y pardonne tout aux lions, aux loups, et aux ours; et un animal innocent est dévoué pour avoir mangé un peu d’herbe. » (Voltaire, Le siècle de Louis XIV, ….)
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) : « Composons, Monsieur de La Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire, avec choix, de vous aimer; de m’instruire dans vos fables, car j’espère ne pas me tromper sur leur objet; mais pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule, jusqu’à ce que vous m’ayez prouvé qu’il est bon pour lui d’apprendre des choses dont il ne comprend pas le quart, que dans celles qu’il pourra comprendre il ne prendra jamais le change et qu’au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon. » (Émile, livre II)
Nicolas de Chamfort (1740-1794) : « Le style de La Fontaine est peut-être ce que l’histoire littéraire de tous les siècles offre de plus étonnant. » (Éloge de La Fontaine, 1774)
Wolfgang Goethe (1749-1832) : « La Fontaine est en si haute estime chez les français, non à cause de sa valeur poétique, mais à cause de la grandeur de son caractère. »
Alphonse de Lamartine (1790-1869) : « On me faisait bien apprendre par coeur quelques fables de La Fontaine, mais ces vers boiteux, disloqués, inégaux, sans symétrie, ni dans l’oreille ni sur la page, me rebutaient. »
Hyppolite Taine (1828-1893) : « C’est La Fontaine qui est notre Homère…il nous a donné notre oeuvre poétique la plus nationale, la plus achevée et la plus originale. »
« la fable est une mascarade; le simple déguisement des animaux en hommes fait sourire. Leur monde est la parodie du nôtre, et leurs moindres actions sont la critique de nos moeurs. La fable est donc par nature une comédie et le poète un railleur. »
André Gide (1869-1951) : « On ne saurait rêver d’art plus discret, d’apparence moins volontaire… on sent aussi qu’il y entre de la malice et qu’il faut se prêter au jeu, sous peine de ne pas bien l’entendre; car il ne prend rien au sérieux. »
Paul Valéry (1871-1945) : « Je ne puis souffrir le ton rustique et faux [des contes de La Fontaine], les vers d’une facilité répugnante, leur bassesse générale, et tout l’ennui que respire un libertinage si contraire à la volupté et si mortel à la poésie. »
Jean Giraudoux (1882-1944) : « Les fables de La Fontaine ne nous montrent pas des hommes prenant des masques de bêtes, mais le contraire. Au-dessous du masque humain qui la couvre, demeure et vit sans trop se douter ce de que le fabuliste lui fait dire, la bête véritable. Au-dessous de cette avarice, de cette adulation qu’on lui impose, existe tout ce qui est félin, fauve, poilu, et parfois transparait d’une façon extraordinaire, écartant le déguisement humain; la candeur ou l’inquiétude animale. » (Les cinq tentations de La Fontaine)
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) : « La Fontaine fait des fables, ben qu’est-ce qui va en faire maintenant?.. Il n’y a rien à ajouter; c’est fait, c’est correct. C’est plein.. C’est ça, c’est tout.. Et pis après, bé dame, après, y a pus rien à faire. »
Pierre Clarac (1894-1986) : « Il est des artistes qui, fixés sur un seul objet, s’efforcent; dans une contemplation immobile, d’y retrouver l’essence de la réalité et les secrets de l’univers. D’autres, tentés par tous les rayons et tous les reflets, dociles à tous les souffles, ne voudraient rien laisser au monde en dehors de leur oeuvre: Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle. Ils promènent à la surface des choses un émerveillement que n’abandonne jamais une secrète défiance. Jouir de tout sans s’attacher à rien, c’est leur devise; c’est celle de La Fontaine. Et c’est pourquoi son oeuvre est à la fois si enjouée et si amère. »
Georges Pompidou (1911-1974) : « La Fontaine, maître dans l’art classique de « faire difficilement » des vers faciles. »
Marc Fumaroli (1932) : « S’il est un lieu où tout le « siècle d’Auguste » vient se résumer, avec toute sa lyre et ses couleurs contrastées, c’est bien dans les Fables, où Virgile, Horace, les élégiaques, retrouvent leur voix sous celle de Phèdre et d’Esope, et où Ovide, qui a chanté tant de métamorphoses d’hommes et d’animaux, revient avec une tout autre séduction alexandrine que chez Benserade ou chez Du Ryer. Lieu d’affleurement de tant de richesses contradictoires de la tradition poétique française, les fables s’offrent en outre le luxe de réverbérer dans toute leur diversité les saveurs de la poésie romaine à son point de suprême maturité. Il y a bien quelque chose de pantagruélique dans l’art de La Fontaine, le plus érudit de notre langue; mais ce qui se voyait chez Rabelais, ce qui était voyant chez Ronsard, s’évapore chez lui en une essence volatile et lumineuse, où des visions dignes d’Homère apparaissent, et ne se dissipent pas. Le génie d’une langue et celui d’une culture millénaire se concentrent ici en un point où la justesse de la voix et celle du regard suffisent à tout dire d’un mot. »
Pierre Desproges (1939-1988) : « Voici une définition tirée du D.S.U.E de Desproges (Dictionnaire Superflu à l’Usage de l’Elite et des Bien Nantis) envoyée par un visiteur de ce site: Ysopet n. m. du latin ysopetus (ysopetae, ysopetam, ysopetorum) Nom donné , au Moyen Age, à des fables ou recueils de fables imitées ou non d’Esope les ysopets d’Anne de Beaugency, de Charles de Brabant de Zézette d’Orléans sont parmi les plus célèbres. Avec cet effroyable cynisme d’emperruqué mondain qui le caractérise, La Fontaine n’hésita pas à puiser largement dans les ysopets des autres pour les parodier grossièrement et les signer de son nom. Grâce à quoi, de nos jours encore, ce cuistre indélicat passe encore pour un authentique poète, voire pour un fin moraliste, alors qu’il ne fut qu’un pilleur d’idées sans scrupules, doublé d’un courtisan lèche-cul craquant des vertèbres et lumbagoté de partout à force de serviles courbettes et honteux léchages d’escarpins dans les boudoirs archiducaux où sa veulerie plate lui assura le gîte, le couvert et la baisouillette jusqu’à ce jour de 1695 où, sur un lit d’hôpital, le rat, la belette et le petit lapin lui broutèrent les nougats jusqu’à ce que mort s’ensuive, ce qui prouve qu’on a souvent besoin d’un plus petit que soi. Essayez de vous brouter vous-même les nougats, vous verrez que j’ai raison. »
Marcel Gutwirth (vivant) : « …dans l’exacte mesure où la fable confère à la bête le don de la parole, elle l’arrache à son mystère, la satellise, modelée qu’elle se retrouve sur la patron des penchants humains — vanité, couardise, jactance, perfidie. Réciproquement, dans la mesure où, ces traits, elle a eu à les loger sous le pelage d’une bête, la fable, en nous transportant hors de nous-mêmes, nous dépayse d’autant, ouvre le champ à l’aventure. » (Un merveilleux sans éclat, La Fontaine ou la poésie exilée.)
Patrick Dendrey (1950) : « L’utile se marie ici à l’agréable, se métamorphose même en forme d’agrément conscient et accepté: il est utile de satisfaire le besoin de beauté et de jouissance gratuite des hommes — il le faut. Ainsi se définit une morale « supérieure » de l’apologue, assimilée au désir de poésie, désir de beauté et de gaieté, conçu comme geste de rupture avec la réalité par la fascination dont il nous charme — mais aussi par l’éveil de conscience que son ironie critique y associe sans contradiction ni césure: car l’apologue « réveille ». Cette double tâche relève du pouvoir de la gaieté, tout à la fois charmeuse et incisive. Et la philosophie supérieure des fables consiste donc en une sagesse de la gaieté qui pourrait se définir comme le charme d’un plaisir lucide en même temps que d’un plaisir de lucidité. »
G.M.