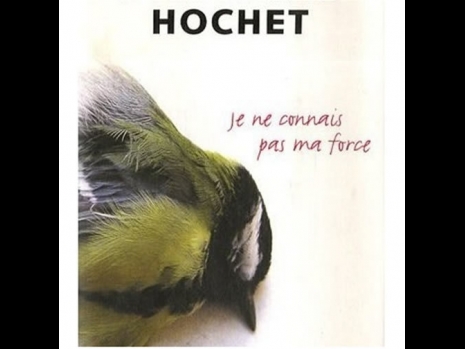Étiquettes
Les Éphémérides de Stéphanie Hochet : une apocalypse littéraire
Je me souviens que le sujet le plus fréquent dans les dissertations aux écoles moyennes et jusqu’au lycée c’était « votre saison préférée ». La plupart de mes camarades choisissaient l’été, la période du maximum de liberté et d’insouciance et surtout de vacances. Moi, je choisissais l’automne, même si je haïssais le jour de la rentrée à l’école, qui tombait le premier jour d’octobre. Car j’étais mélancolique. J’aimais les feuilles mortes. « Vous avez raté le devoir, disait le maître, c’est le printemps la saison que vous auriez dû choisir. La saison de l’épanouissement de la fleur, donc de la vie, la saison du commencement, de l’espoir et de l’idée de liberté ». D’ailleurs, cette « idée de liberté » n’avait rien à voir avec la fausse liberté qu’on laisse aux troupeaux de paître dans un champ d’herbe brûlée.
Ainsi, le jour du printemps est « culturellement » reconnu comme le jour plus beau, celui qui donne du sens à cette vie sinon insensée. Certes, le moins adapté pour mourir.
Je me souviens pourtant d’un vers latin : « Dulce et decorum est pro patria mori/mors et fugacem persequitur virum/nec parcit inbellis iuventae/poplitibus timidove tergo » (Horace, les Odes, III.2.132), qu’en français résonne ainsi dans ma tête : « Il est doux et honorable de mourir pour sa patrie :/La mort poursuit l’homme qui s’enfuit,/ni n’épargne les jarrets ou le dos lâche/Des jeunes gens peu aguerris » (texte souvent évoqué par les partisans de la Première Guerre mondiale, à ses débuts).
Tout de même, dans une scène incontournable du film Little Big Man d’Arthur Penn (avec Dustin Hoffmann, 1970), je ne peux pas oublier l’expression tout à fait séraphique du vieux chef des Indiens peau rouge qui s’étend sur un rocher en se disposant avec confiance à la mort avant de dire : « Aujourd’hui c’est un beau jour pour mourir ! » Cette idée à la fois fataliste et héroïque de la mort fait partie désormais d’un bagage intérieur dont j’aurais de la peine à me débarrasser. Car j’ai toujours le sentiment, en général, que la mort ne fait qu’un avec la vie. D’ailleurs, jusqu’à la fin de la vie, comme si bien disait le marquis de La Palice, on est encore vivants : « il mourut le vendredi/le dernier jour de son âge/s’il fût mort le samedi/il eût vécu davantage » (chanson populaire, XVIIIe siècle).
Et alors, puisqu’on doit vivre jusqu’au dernier moment, dans l’attente incertaine de la mort ou d’un peu de vie encore, pourquoi ne pas fixer cet horizon de la mort dans un moment précis de l’année, celui qui symbolise au plus haut degré le triomphe de la vie ?
C’est peut-être à partir de cette évidence que Stéphanie Hochet — en alternative à la date sombre et antipathique que le catastrophisme dominant impose — a décidé de choisir pour « sa » fin de monde le 21 mars 2012. Cette « échéance », au lieu de nous apporter une vraie apocalypse, nous fait cadeau de son huitième roman, Les Éphémérides (Rivages, 2012). Ce livre, ayant dépassé déjà la date fatidique, se trouve maintenant sain et sauf dans mes mains. Je l’ouvre avant de commencer vraiment à le lire. À la page 95 je trouve ces mots : « Je me demande ce que c’est. Ils ont dit que ça se passerait le 21 mars, pendant l’équinoxe de printemps. Pourquoi pas ? C’est une belle date pour mourir. Si j’avais eu le choix, sans doute que j’aurais préféré cette date à une autre. En tout cas je ne suis pas triste, puisque je l’ai retrouvée. »
Les Éphémérides c’est un « nouveau commencement », après un premier cycle, déjà important, d’œuvres homogènes dans les sujets et dans le style. Une positive « rupture » avec le passé, mais aussi une systématisation, dans une nouvelle perspective, des sources primordiales de son inspiration.
Stéphanie Hochet s’écarte nettement vis-à-vis des écrivains français de sa génération. Elle est une « outsider » mais aussi une « championne ». D’un coté elle possède un monde à soi, qu’elle élabore de façon tout à fait originelle — et ouverte aux « autres ». De l’autre côté elle maîtrise une langue où la poésie n’est pas sacrifiée à la prose, ni la prose à la poésie. Déjà dans les romans qui précèdent Les Éphémérides on reconnaît un parcours créatif où les thèmes des histoires racontées — et les caractères des personnages choisis — s’évoluent au milieu d’une cohérence formelle et poétique du texte littéraire tout à fait impressionnante.
Cela se traduit en de choix constants et rigoureux : une vision désenchantée de la réalité de nos jours, toujours accompagnée d’une merveilleuse capacité poétique d’y cueillir quelques fragmentaires beautés ; le choix de sujets toujours étrangers aux problématiques individuelles de l’auteur, comme un fait divers pris de la chronique, ou aussi quelque chose dont on parle, qui arrive ici ou là dans le monde — des prétextes, en général, auxquels l’auteur ne semble pas donner trop d’importance ; le choix de personnages difficiles et inadaptés dont le malaise — qui se traduit souvent en méchanceté — est toujours conséquence de l’abandon familial et/ou de la ségrégation sociale ; l’assignation du rôle de protagoniste à personnages de n’importe quel sexe, habitude et usage, n’affichant, elle, aucune difficulté à se plonger dans des figures parfois à l’opposé vis-à-vis de sa sensibilité personnelle ; l’ouverture envers « le point de vue de Caïn », c’est-à-dire la disponibilité à regarder aussi le Bien que le Mal sans préjugés ni préconçus ; un penchant particulier pour le thème de l’apocalypse, présent déjà dans Je ne connais pas ma force (Fayard, 2007) et, encore avant, dans L’Apocalypse selon Embrun (Stock, 2004), récit, selon Amélie Nothomb, « d’une maturité stupéfiante, [où] Stéphanie Hochet excelle à distiller, à la manière du Polanski de Rosemary’s Baby, un climat de subtile inquiétude métaphysique. » ; la présence constante d’une idée positive de « guérison » ou quand même de « survivance active » ; l’assomption du « combat » comme outil du quotidien pour aller au-delà de tout cercle vicieux et immobilisant, sans craindre les ruptures, si inévitables ; le défi permanent, sur le plan de l’écriture. Petite Trotzki de la littérature, Stéphanie Hochet, sans jamais trahir ses sources primordiales, semble toujours prête à révolutionner, jusque de la base, ce qu’elle vient juste d’atteindre.
Le « retour sur les lieux »
La merveilleuse continuité du parcours narratif de Stéphanie Hochet est à la base de sa décision de situer Les Éphémérides en Écosse et à Londres. Le peu de biographie qu’on connaît de cette écrivaine toujours « en dehors de la mêlée », nous certifie qu’avant de sortir avec son premier roman (Moutarde douce, Robert Laffont 2001), elle a vécu et travaillé pendant une longue période en Écosse.
Ensuite, dans son cinquième livre, Je ne connais pas ma force, Karl Vogel, le protagoniste, voudrait traverser la Manche pour « repartir à zéro » dans une nouvelle vie, loin de la famille et de nombreux fantômes dont il doit s’affranchir.
Cinq ans après, Les Éphémérides s’ouvre avec le monologue de Tara, une jeune Écossaise que la vie a rendue capable, finalement, de s’imposer à tout le monde, ne faisant recours qu’à une enviable maîtrise d’elle. Tara, après une séparation de trois ans, accepte d’accueillir à Glasgow Alice, une jeune Française qui, pressée par l’Annonce de la « fin du monde », trouvera enfin la force de la rejoindre.
On ne peut pas éviter de constater que Karl Vogel, en son roman de 2007, n’avait pas eu assez de force pour le faire lui-même. Nous songeons aussi à l’hypothèse de la fascination pour cet ailleurs écossais — ainsi différent vis-à-vis du contexte et des paysages français — qui aurait à plusieurs fois poussé notre écrivaine à « revenir sur les lieux ». Peut-être la difficulté d’aller à la rencontre de son propre passé, qui comporte toujours une transgression et un défi assez engageant, a entraîné l’idée du danger. C’est le mythe d’Orphée : revenir en arrière c’est toujours briser un tabou. Et alors c’est bien possible que dans la fantaisie créatrice de Stéphanie Hochet il y ait eu un relais entre le désir — et la peur — de briser un tabou désormais cristallisé en elle et l’idée d’une explosion terrible qu’une transgression peut provoquer.
Du « je » à la polyphonie
Au point de vue strictement littéraire, les motifs inspirateurs des romans de Stéphanie Hochet — pour la plupart centrés sur la phénoménologie du malaise de l’âge enfantine et de l’adolescence — ont beaucoup évolué avec l’adoption (à partir de Je ne connais pas ma force) du « je » à la place de la troisième personne.
L’adoption du « je » — qui vient de loin, de Montaigne et Rousseau, en passant par Gide et Mauriac — se traduit pour la plupart des écrivains en libération vis-à-vis de l’écriture. Pour Stéphanie Hochet, au contraire, ce choix se configure plutôt comme une forme d’engagement, autant plus nécessaire que ladite « phénoménologie du malaise » l’oblige à donner une particulière visibilité à ses personnages. Grâce au « je », ils ont finalement la chance de s’exprimer, non seulement dans leurs actions physiques et verbales, mais aussi à travers leurs rêves les plus inavouables.
En même temps, avec l’adoption de ce « je » le lecteur est engagé dans une participation active à la structuration de l’histoire et de son sens en relation au contexte. Songeant à cette participation, je me figure une torche qui cherche des objets dans le noir. Cette torche, à la lumière faible ou aveuglante selon l’énergie des batteries, est pour moi la voix du personnage qui raconte, en se racontant. Dans son parcours, par hasard, la torche peut rendre visible un interrupteur. C’est alors au lecteur de déclencher la lumière générale et aussi d’en régler l’intensité. Il pourra ainsi acquérir des éléments d’objectivité qui sont nécessaires à rééquilibrer le sens de l’histoire et à mieux expliquer son dénouement.
Dans les deux premiers romans consacrés au « je » et au « combat intérieur » (Je ne connais pas ma force ; Le combat de l’amour et de la faim, Fayard 2009), Stéphanie Hochet avait frôlé aussi l’autobiographie, avançant, comme Jean Jacques Rousseau, dans une alternance de rêverie et réflexion, à la recherche de réponses à de questions difficiles, parfois intimes. Dans ces romans elle avait partagé son « patrimoine de questions et de troubles » avec des personnages engagés dans la recherche d’eux-mêmes. Grâce à la « mesure » littéraire de Stéphanie Hochet (capable de modérer la démesure « humaine »), les personnages de Karl et Marie — plus proches à l’esprit de Dostoïevski qu’à celui de Rousseau — ont enfin atteint une identité positive, tandis que le lecteur a pu déverser, dans leur même creuset, les souvenirs touchants de son propre passage à l’âge de raison.
Entre Le combat de l’amour et de la faim et Les Éphémérides, un roman mitoyen, La distribution des lumières (Flammarion 2010), tout en gardant certains sujets dudit « malaise de l’adolescence », introduit des éléments nouveaux. À côté d’un garçon et d’une fille qui doivent leur malaise à l’égarement familial et social dans une banlieue de Lyon, un personnage adulte entre en jeu et se raconte avec son « je ». De là la première expérience polyphonique ou, si l’on veut, rapsodique de Stéphanie Hochet.
Dans le final de cet avant-dernier roman Stéphanie Hochet trouve un point de fugue pour toutes les histoires racontées, comme dans une perspective classique. Le récit fonctionne et le final est touchant et poétique. Cependant, quelque chose d’inachevé reste dans l’esprit du lecteur.
Quelque chose que dans Les Éphémérides a trouvé un merveilleux aboutissement.
Une apocalypse littéraire
Je ne veux pas ici trop fouiller dans les exemples passés et, en particulier, dans L’école des femmes d’André Gide, que je considère le livre de référence pour cette nouvelle forme de dramatisation d’histoires touchant plusieurs personnes que Stéphanie Hochet a adoptée. Dans ce texte classique, évidemment, comme il arrive aussi dans Crime et châtiment de Dostoïevski ou dans L’Étranger de Camus, il y a au fond l’idée d’un procès, l’attente d’un jugement où le lecteur serait un des 12 jurés appelés à condamner ou absoudre.
Dans Les Éphémérides de Stéphanie Hochet toute question de jugement semble rester suspendue. Pourtant une tragédie menaçant la planète à la date prévue du 21 mars 2012, juste au commencement du printemps, va rendre nécessaire une « escalation » dans la dramatisation polyphonique : ce monde fou fou fou, comme on l’appelle à page 17 (It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World est le titre d’un célèbre film américain de Stanley Kramer, 1963), sera effacé en un seul jour par une explosion bactériologique incontournable. Dans ce qui doit arriver selon l’Annonce, ce sont les hommes les seuls responsables. Et les hommes qui doivent s’y confronter (Tara et Simon Black in primis) en sont pleinement conscients. D’ailleurs, que pourraient-ils faire ? Il est trop tard pour n’importe quelle réaction.
C’est le thème de la « mort collective annoncée » et de sa chronique, à la fois passionnante et objective. Une « fin de monde » partielle, concernant « l’Occident de l’Europe », épargnant peut-être les autres Continents, qui semble avoir son épicentre en Angleterre, concernant Paris aussi.
Comme nous dit très efficacement Amélie Nothomb, « tout cela semble délirant, mais chaque fois qu’on se demande où l’auteur veut en venir, on est forcé de constater que c’est exactement ce qui se passe maintenant. La fin du monde se déroule sous nos yeux et personne ne réagit autrement que par des projets personnels dérisoires… [et] Stéphanie Hochet suggère avec panache et drôlerie que la fin du monde pourrait bien ne rien révéler… » (Le Monde, vendredi 30 mars 2012).
Derrière cette « apocalypse » il y a une idée de globalisation qui n’a rien à voir avec les anciens affrontements, en France et en Europe, entre idéologies et cultures rigidement séparés, ni avec toutes les fabriques d’illusions de l’Occident, qui voudraient, encore aujourd’hui, nous faire croire durable un bonheur qui ne peut être qu’éphémère.
En même temps, chaque vie humaine est une petite étoile qui brille pour son plaisir et pour le restreint bonheur — ou malheur — de ses proches. Avec l’explosion de la mort collective l’idée du néant, du trou noir fabricateur de galaxies s’affirme. Je vois alors les personnages éphémères du roman de Stéphanie Hochet — choisis par l’auteure en raison de leur force symbolique — devenir une nouvelle constellation d’Éphémérides dans le firmament post-contemporain.
Nous vivons aujourd’hui dans une époque extrêmement dérangée, schizophrène et surtout solitaire où le mal-être peut facilement déborder dans le malfaire ; où, en général, chacun finit par se fabriquer un monde à lui, où les critères de la morale classique sont de plus en plus bouleversés, sinon complètement mis de coté. Et souvent les drames individuels, liés à ces solitudes, ne réussissent pas à briser le mur sourd d’un manque généralisé d’attention, devenu de plus en plus insurmontable.
Dans l’esprit de Stéphanie Hochet un tel genre de « fin du monde » peut engendrer des fabuleuses possibilités narratives. C’est une véritable contrainte, moins stricte par rapport à celle que Georges Pérec s’était obligé à respecter, en écrivant, avec La disparition (Denoël 1969) un entier livre ne comportant pas une seule fois la lettre « e ». Mais, en tout cas, c’est une contrainte dont on doit profiter.
D’ailleurs, cette particulière idée de « mort collective » peut aisément assumer la fonction de relativiser les sentiments et les passions des acteurs du drame dans une fresque capable de les unifier, tandis que la polyphonie des trois « je » qui racontent leurs derniers moments de vie, va se lier strictement à cet élément de l’Annonce, quoiqu’il soit vague, invisible et insaisissable.
En définitive, dans Les Éphémérides, en faisant rencontrer l’apocalypse individuelle (endémique et souterraine) avec l’apocalypse collective (épidémique et évidente), Stéphanie Hochet trouve aussi une façon positive de mettre en relation les différentes voix de la rapsodie, en lui donnant ainsi un rythme passionnant et mélancolique.
L’apocalypse et ses témoins
Dans un autre commentaire (« Les Éphémérides de Stéphanie Hochet : une partition théâtrale ») j’ai développé une analyse plus détaillée du texte des Éphémérides. J’en ai tiré, en définitive, l’idée d’une fresque où le témoignage doit nécessairement prendre le dessus par rapport aux histoires personnelles, du moins à travers un décor de fond et un climat psychologique qu’on respire à contre cœur. Je me suis alors souvenu des merveilleuses pages de Pline le Jeune, du récit effrayant de l’éruption du Vésuve, le 24 août du 79 après J.C. : « Il était à Misène et dirigeait lui-même la flotte… Ma mère me montre vers la septième heure [environ 13 heures] qu’il lui apparaît un nuage d’une grandeur et d’un aspect inhabituels… Un nuage montait (pour ceux qui l’observaient de loin, il était incertain de quelle montagne il venait; on sut par la suite qu’il provenait du Vésuve); et aucun autre arbre que le pin n’y ressemblait davantage à son image et à son aspect… En effet, en s’élevant sous la forme d’un tronc très long, il s’élargissait dans les airs en rameaux, je crois, parce que, une fois emporté par un vent nouveau, ensuite abandonné par le vent qui s’affaiblissait, ou même vaincu par son propre poids, le nuage se dissipait en largeur, blanc de temps à autre, parfois sombre et sale, selon qu’il soulevait de la terre ou des cendres… Déjà les cendres tombaient sur les bateaux; plus ils approchaient, plus elles devenaient chaudes et denses; déjà aussi c’étaient des pierres ponces et des cailloux noirs, carbonisés et brisés par le feu; déjà le fond de la mer semble se soulever et le rivage fait obstacle par les éboulis de la montagne… Pendant ce temps, des flammes très larges et de gros incendies luisaient en plusieurs endroits du mont Vésuve; leur éclat et leur clarté étaient avivés par les ténèbres de la nuit… Déjà ailleurs c’était le jour, mais ici la nuit était plus noire et plus dense que toutes les nuits; et pourtant de nombreuses torches et diverses lumières l’atténuaient. » (Pline le jeune, lettre à Tacite au sujet de la mort de Pline le vieux)
En relisant aujourd’hui cette lettre — racontant une apocalypse qui submergea toute la plaine de Naples jusqu’au Cap Misène, en faisant disparaître (pour mieux la conserver !) la ville entière de Pompéi sous une couche épaisse de cendres —, j’y retrouve quelques images ou plutôt quelques sensations évoquées dans le livre de Stéphanie Hochet.
Voilà. Après lecture, ce roman choral ne cesse de chanter dans ma tête. Les personnages — que la sage mise en scène de Stéphanie Hochet a dû de quelque façon limiter, en les sacrifiant à l’économie générale et au succès théâtral et musical de la « pièce » —, reviennent à la mémoire, pour expliquer le possible sens caché dans leurs prénoms, ou pour signaler l’importance de leur contribution à la réussite finale.
Tara, pour commencer, est aussi le nom de la ferme du célèbre film américain Autant en emporte le vent (Gone with the Wind, Victor Fleming, 1939).
Alice passe de la France à l’Angleterre comme une autre inoubliable Alice à travers son miroir (dans Les Aventures d’Alice au pays des merveilles — Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carrol 1865).
Simon Black c’est parfait pour un peintre, tandis qu’en Ecuador le prénom absorbe tout, jusqu’à l’image physique incertaine de cette femme aussi fatale que fragile. L’amour passionné de Simon, que cette femme du mystère partage vivement, devient un hommage inattendu à la littérature d’amour et cela dépend peut-être du fait que cet amour n’est pas vraiment décrit ni imposé à la vue.
Quant à Ludivine, dont le nom est peut-être inspire à la jeune hollandaise immortalisée par le célèbre écrivain de la décadence J.K. Huysmans dans son livre Sainte Lydwine de Schiedam (1901), est très intéressant ce que nous dit Amélie Nothomb : « Freud signale que l’enfant peut devenir pervers polymorphe. Stéphanie Hochet absolutise ce constat : dans son œuvre, tous les enfants sont des monstres malfaisants. Les Éphémérides ne fait pas exception ». Et voilà ce que A. Nothomb avait déjà dit en 2004 à propos de L’Apocalypse selon Embrun et de…, son personnage principal : « Mais non, protestera le meilleur de nous-même, un enfant ne peut pas être le Mal. A l’instant où nous refusons d’y croire, la part la plus obscure de notre être nous rappellera la petite nièce odieuse ou le gosse que nous baby-sittions en brûlant de le jeter par la fenêtre tant il était gratuitement abject. Des enfants imbuvables, nous en avons tous connu plusieurs. Nous réglions la question de généreuse manière : Ce sont des victimes, c’est la faute des parents, d’une mauvaise éducation, de la télévision, de la société, etc. […] Oui, bien sûr. Là encore, la part la plus obscure de notre être nous rappelle que la petite nièce odieuse avait une grande sœur charmante qui avait pourtant reçu une éducation identique, que tel môme défenestrable était adorable avec tous sauf avec nous, et autres signes troublants de la perversité de certains enfants. C’est sur ce constat inavouable que fonctionne le roman de Stéphanie Hochet. […] Son texte est jubilatoire, mais l’auteur a l’élégance et l’intelligence de ne pas abuser de ce qui pourrait être une aubaine narrative : le thème de l’enfant maléfique n’est pas ici surexploité. »
Après le déluge, les mots de Saramago
Comme j’avais dit, Stéphanie Hochet a un particulier penchant pour le point de vue de Caïn et les Apocalypses. Dans Les Éphémérides elle parle d’une Arche (de Noé) et des animaux (du déluge universel) qu’y entrent. En prenant cela comme prétexte et petite provocation — car je trouve qu’après la « fin du monde » ici exploitée, de l’Arche ne sortiront que des chiens noirs — je crois que la scène finale, imaginée par José Saramago (Prix Nobel 1998) pour son Caïn (Seuil 2011), pourrait très efficacement décrire ce que peut se passer après le déluge des Éphémérides : « Le lendemain, l’embarcation toucha terre. On entendit alors la voix de dieux, Noé, noé, sors de l’arche avec ta femme et tes fils et les femmes de tes fils, retire aussi de l’arche les animaux de toutes espèces qui sont avec toi, les oiseaux, les quadrupèdes, tous les reptiles qui rampent à terre, afin qu’ils s’éparpillent dans le monde et se multiplient partout. Il y eut un silence, puis la porte de l’arche s’ouvrit lentement et les bêtes commencèrent à sortir. Elles sortaient, sortaient interminablement, les unes grandes comme l’éléphant et l’hippopotame, les autres petites comme les lézardes et la sauterelle, d’autres de taille moyenne comme la chèvre et la brebis. Quand les tortues, qui furent les dernières, s’éloignaient, lentes et solennelles, comme c’est dans leur nature, dieu appela, Noé, noé, pourquoi ne sors-tu pas. Venu de l’intérieur sombre de l’arche, caïn apparut sur le seuil de la grande porte. Où sont noé et les siens, demanda le seigneur. Par là, morts, répondit caïn, Morts, comment cela, morts, pourquoi, Sauf noé, qui s’est noyé librement, volontairement, les autres, je les ai tués. Comment as-tu osé, assassin, contrarier mon projet, est-ce donc ainsi que tu me remercies d’avoir épargné ta vie quand tu as tué abel, demanda le seigneur. Le jour devait venir où quelqu’un te placerait devant ton vrai visage, Alors la nouvelle humanité que j’avais annoncée, Il y en a eu une, il n’y en aura pas d’autre et personne ne la regrettera. Tu es caïn, le méchant, l’infâme meurtrier de ton propre frère, Pas aussi méchant et infâme que toi, rappelle-toi les enfants de sodome. Un grand silence se fit. Puis caïn dit, Maintenant, tu peux me tuer, Je ne peux pas, dieu ne revient pas sur sa parole, tu mourras de mort naturelle sur la terre abandonnée et les oiseaux de proie viendront délirer ta chair, Oui, après que toi tu m’auras d’abord dévoré l’esprit…»
Giovanni Merloni