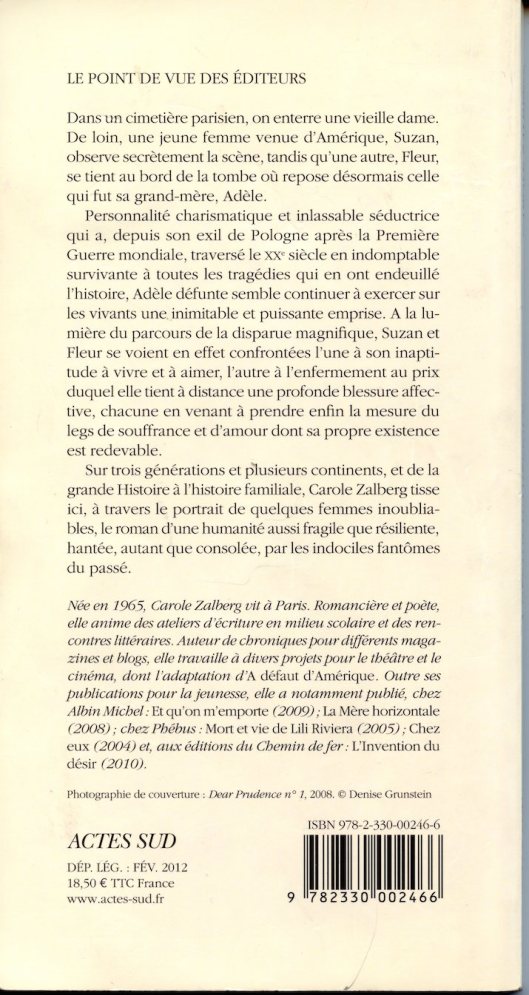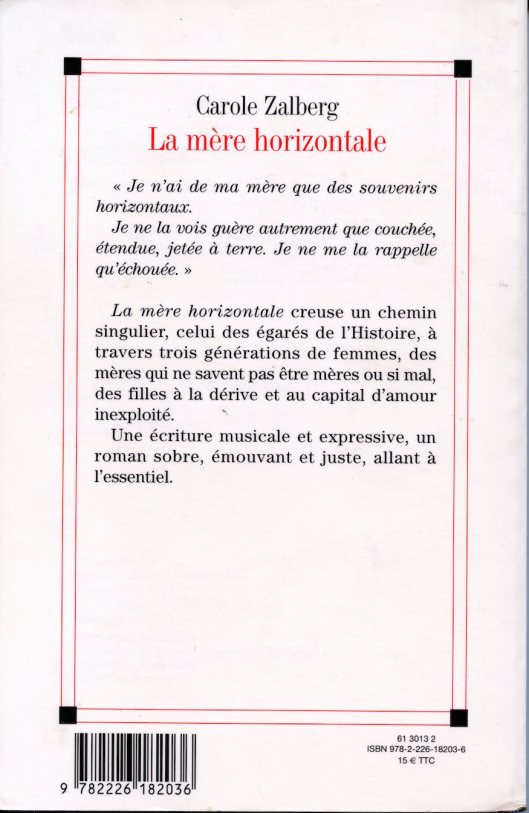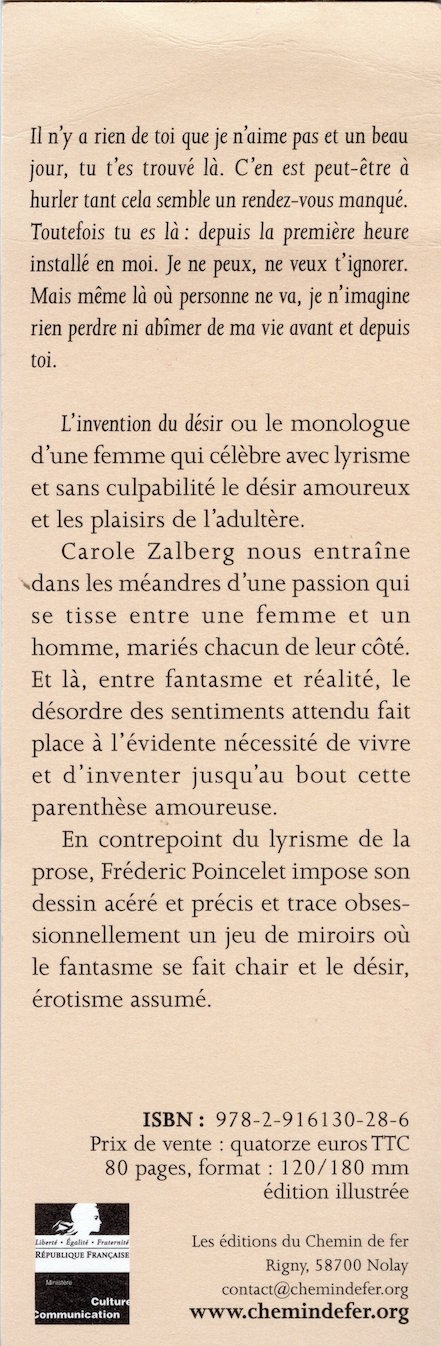Le roman de Germaine, un texte prémoni-toire de Barnabé Laye I/II
Le roman de Germaine, un texte prémoni-toire de Barnabé Laye I/II
« Une femme dans la lumière de l’aube » de Barnabé Laye est un livre profond et juste, dont le message moral et humain va bien au-delà de cette image du titre…. Une image élégante, mais assez « légère », à mon avis, par rapport à la valeur poétique ainsi qu’au contenu réel du roman.
D’ailleurs, cette « femme » évoquée s’appelle Germaine. Guide charismatique tout au long du « voyage dans le pays du père », elle n’est pas du tout une femme quelconque.
(Ce livre aurait d’ailleurs mérité une couverture plus sobre et moins envahissante. Mais j’expliquerai après, avec mon enthousiasme, les raisons de cette toute petite observation…)
L’année dernière, j’avais assisté, près de l’Espace Mompezat (siège de l’Association des Poètes français) à la lecture, qui m’avait touché, du recueil de poèmes « Par temps de doute et d’immobile silence » de Barnabé Laye ayant comme thème la nostalgie du pays natal et protagoniste absolu le Nil. J’avais même cru que ce poète était égyptien, tellement intense et dramatique, dans l’assistance, résonnait la voix de Claire Dutrey en train de dire ses vers par cœur.
Barnabé Laye est né à Porto-Novo dans le Bénin (1), ce petit pays traditionnellement lié à la France qui s’accoude sur le Corne d’Afrique tout en gardant à son intérieur d’énormes trésors de beauté artistique et naturelle.
D’ailleurs le Nil — cette longue cravate d’eau bénéfique venant du cœur du continent africain pour se jeter d’un air hautain et solennel dans la Méditerranée — représente pour notre Auteur une deuxième patrie africaine, un point de repère de l’espérance.
Ensuite, j’avais lu quelques-unes de ses poésies, en y découvrant une grande force et cohérence. Une expression assez simple, très proche de la langue parlée, illuminée d’ailleurs par des éclats d’originalité absolue. Mais je ne savais encore rien de cet homme au chapeau, très gentil et toujours souriant, que j’entendais lire ses poèmes d’une voix envoûtante et persuasive… la voix d’un père, d’un guide qui assume ses responsabilités avec un fatalisme joyeux… avec cette capacité de sortir du quotidien d’un instant à l’autre par le coup de queue d’un seul mot, d’une seule phrase remontée subitement à la mémoire…
Récemment, on s’est trouvés par hasard autour d’une table dînatoire et l’on a profité pour échanger sur plusieurs sujets. Ce fut d’ailleurs une rencontre entre deux hommes au chapeau, avec le même attachement fétichiste et fataliste à cet outil primordial.
Peut-être, le petit Borsalino a plané sur la tête de Barnabé de la même façon où le chapeau à la Indiana Jones est devenu indispensable pour moi. Comme mes lecteurs affectionnés le savent, mon penchant exagéré pour le chapeau vient surtout de l’image hiératique de mon grand-père paternel — dont j’ai trouvé rarement des photos tête nue —, tandis que « Père » est le premier mot-clé qui affleure aux lèvres lorsqu’on s’aventure dans le monde poétique et romanesque de cet Auteur exceptionnel pour ne pas dire tout de suite Grand.
À partir de cette « affinité de chapeaux », j’ai délibérément transformé notre rencontre conviviale en interview. Cela a fait déclencher mon engagement d’esquisser un portrait de Barnabé Laye à travers son œuvre. Je lui ai donc demandé de me parler de ses romans, plutôt que de sa vie.
Il a choisi son premier roman publié en 1988 par Seghers — « Une femme dans la lumière de l’aube » — très adapté au but de retracer le parcours d’une vie consacrée à la poésie et à la littérature.
La liste de ses publications est d’ailleurs assez longue. Des textes importants avaient déjà circulé en France avant ce roman. D’autres livres, dont deux romans, ont été publiés après.
Donc, je dois faire attention et le lecteur aussi. On n’a pas le droit de trancher un jugement ou même une impression à partir d’un seul livre, même s’il est peut-être le plus important de sa vie.
Oui, dans la tradition des patriarches, l’enfant aîné demeure pendant quelque temps le fils unique, celui qui nous cause la plupart des appréhensions et des surprises. Mais après, on s’affectionne aussi à l’enfant cadet, à la fille qui arrive en troisième devenant la coquine du père…
Et pourtant, fermant les yeux après la lecture de ce livre-aîné, j’ai le sentiment d’avoir touché à une œuvre vraiment exceptionnelle. Car je vois là-dedans une heureuse synthèse entre poésie et prose ainsi qu’entre les différentes âmes et formes expressives de cet Auteur prodigieux. Il me semble que cela représente déjà le pivot et le primordial point de repère des créations successives, même si la poésie jouera dans le temps un rôle de plus en plus autonome.
Dans « Une femme dans la lumière de l’aube » — qu’on pourrait titrer aussi bien « Le roman de Germaine » —, on découvre en filigrane des faits et des circonstances de la vie de Barnabé Laye qui expliquent le rôle primordial que la poésie assume dans la création de sa prose évocatrice et fabuleuse qui ne déborde pourtant jamais d’une architecture narrative solide et cohérente.
D’abord, il y a l’événement crucial du changement brusque de ciel et de vie en 1961, à l’âge très jeune et délicat des 20 ans à peu près, quand Barnabé, ayant reporté le premier prix au bac français dans son lycée au Bénin, eut la chance de partir à Bordeaux pour y suivre ses cours universitaires à la faculté de Médecine, avant de s’installer, en 1971, définitivement à Paris.
Ce serait intéressant d’imaginer la double existence de ce jeune hématologue à la Pitié-Salpêtrière, qui profite de tous les petits intervalles pour écrire des poésies renouant, à travers elles, les fils coupés de sa destinée tout à fait spéciale.
Mais je préfère me plonger avec vous dans cette « odyssée » donnant lieu à une seconde naissance, destinée à remplacer son sentiment de déracinement et d’exclusion vis-à-vis de ses origines intimes…
Je vais donc remémorer dans ma tête les nombreux plans de cette narration « sans exclusion de coups », au rythme envoûtant et serré, où l’on évoque l’importance de la tradition orale et, en même temps, du dialogue intérieur.
Comme on a pu bien comprendre, ce texte de Barnabé Laye jaillit spontanément, comme une cabale, des mots magiques et solennels du père.
Cependant, ce roman de l’amour du père pour son enfant, que celui-ci partage avec une dévotion sans bornes est aussi le roman de l’amour, aussi réciproque, entre la mère et le fils.
On dirait que ce voyage dans le pays du père est aussi le voyage où l’on espère de ressusciter la mère morte et de reconstruire, à travers elle, l’esprit et l’âme de la patrie.
Un véritable voyage à la « découverte de soi », où trois voix s’alternent et se mêlent dialectiquement :
— la voix du père, qui est aussi la voix du pays ;
— la voix de Germaine, cette femme charmante et charmeuse qui pourrait être une tante ;
— la voix intérieure du jeune protagoniste, qui incorpore en elle la voix et la figure invisible de la mère…
« C’est peut-être cela une mère, cette chose que je ne connais pas… …Ma mère est morte en couches. Les médecins n’y ont rien compris. C’est le cœur. C’est le cœur qui a lâché. L’amour de l’enfant a grandi dans ce cœur, il a grossi, au-delà de toute mesure. L’enfant attendu, après tant d’années de mariage…. Elle a pris l’enfant dans ses bras, l’a couché sur son ventre, l’a recouvert de ses mains et puis son cœur a explosé. Le cœur gros, trop gros, rempli de l’enfant. Et mon père, comme un arbre desséché, est devenu à la fois père et mère pour ce berceau blessé. Cela s’est passé, un soir de novembre, à Villacoublay… Certains soirs, je le sais, au sortir du bureau, il faisait le détour par le cimetière. Mais, de cela, il ne parlait pas. » (pages 24-25)
Pour fondre cette polyphonie en un seul train narratif, basé sur l’unité de l’espace et du temps, Barnabé Laye a dû évidemment recourir à la fiction et au renversement des rôles entre personnages réels et personnages imaginaires.
Dans cet esprit, l’Auteur projette certaines circonstances de son propre destin sur la figure du père tandis que le fils, protagoniste et narrateur à la première personne, serait né en France, à Villacoublay, dans la banlieue parisienne. Donc, au commencement de cette histoire, Celui-ci arrive en Afrique pour la première fois. Il a presque le même âge que l’auteur du roman lors de son décisif départ en France.
Ce renversement est d’ailleurs indispensable pour créer un pont vers les nouvelles générations, en évoquant le drame des gens originaires de pays lointains qui sont gâtés par un contexte fort évolué comme celui de la France, mais sont aussi confrontés au « devoir » de renouer leur lien identitaire avec leurs racines (2).
Bien sûr, il n’y a pas que ce devoir « rituel », imposé de l’extérieur, par quelqu’un qui ne nous connait pas et ne nous connaitra jamais.
Chacun de nous est spontanément sensible à l’hypothèse d’un retour idyllique aux origines, engendré par la nostalgie sincère de notre langue maternelle et de nos propres habitudes refoulées.
Barnabé Laye ressent vivement et intimement ce rappel du pays du père et de la mère.
Il éprouve toutefois un malaise, un poids psychologique, le sentiment d’une situation contradictoire, d’une déchirure qu’on ne guérira jamais.
Voilà pourquoi il décide d’envoyer le fils… à sa place. Car évidemment il n’est pas possible de renouer ce qui a été coupé, désormais. Revenir en arrière c’est une illusion et retourner sur le « lieu du délit » ce serait une faute encore plus grave.
Il décide alors de faire éclater les contradictions liées à l’impossibilité de « faire la navette » entre deux réalités étanches. D’autant plus que cette condition « d’éternel étranger », s’ajoutant aux drames familiaux, se traduit pour ce jeune homme inquiet en empêchement de vivre pleinement une vie normale.
Dès la première page du roman, ce jeune homme noir se voit catapulté dans son pays d’origine, soudainement perturbé par une tentative de coup d’État et une répression tout à fait inattendue. À son drame personnel s’ajoute, sans transitions, la tragédie d’un pays qui subit de but en blanc une violente transformation l’effondrant dans la détresse et la peur :
« …dans les regards inquiets, les salutations dérident les rires figés : — Que le jour te soit bon. Attention au couvre-feu. — Que le jour te soit bon aussi. Couvre-toi bien, répond l’autre. Puis il lui prend la main et lui parle tout bas de ces choses qui ne peuvent se dire à voix d’homme, il y a eu une réunion secrète hier dans la nuit, tous les ministres étaient présents autour du grand patron, chacun armé jusqu’aux dents, la décision a été prise de frapper fort, de frapper les réactionnaires, tous les mous, les tièdes, les opposants, les étudiants, frapper tous ceux dont le silence et les yeux ne se peuvent supporter… Déjà deux mille cinq cents personnes arrêtées… Couvre-feu, couvre-toi, le frère ! » (page 58)
Au cours de cette « rapatriée » qu’il avait prévu tout à fait pacifique, il se trouve au contraire pris au piège jusqu’à perdre le nord et même à négliger son statut d’étudiant universitaire positivement installé dans une réalité fort équilibrée et progressive. Les événements externes le bouleversent, en l’empêchant de poursuivre le but primordial de sa visite en Afrique.
Heureusement, au beau milieu de cet égarement douloureux, une belle surprise éclate. Il rencontre Germaine et, à travers elle, la voix de la réalité. Une réalité extrêmement dure, mais aussi dense de découvertes et de saveurs.
Dès l’atterrissage de son avion, le jeune protagoniste avait été très mal accueilli par le pays longuement rêvé : on lui avait volé la valise avec tous ses documents, il était tombé dans un piège lors d’un accident de voiture, il était fini en prison.
« — Sujet de sexe masculin, âge 21 ans environ, arrivé d’Europe ce jour par le vol UTA 256, affirme venir dans le pays de son père pour la première fois… Devait loger chez son oncle, mais ce dernier a quitté la ville sans laisser d’adresse… Appréhendé pour vagabondage sur la voie publique et participation à attroupements non autorisés par le préfet de police… » (page 17)
Les perspectives deviennent sombres, jusqu’au moment où il rencontre une silhouette féminine qui lui adresse la parole.
D’une génération plus âgée que lui, Germaine adopte d’instinct le jeune homme l’entraînant dans sa petite communauté.
Elle partage avec bienveillance les souhaits de son hôte qui voudrait rencontrer son oncle quelque part dans le pays ainsi que son père. Mais la petite sérénité initiale, qui avait rempli de curiosité et d’embarras le jeune « étranger », est brusquement interrompue.
Dans une séquelle d’événements de plus en plus menaçants et inattendus, on apprend la mort de l’oncle politiquement engagé et on commence à endurer une crise qui se termine dans un invisible et pourtant évident coup d’État.
Bien tôt, Germaine aussi est menacée et doit quitter son quartier, abandonnant la ville près de la grande lagune.
« Le regard rieur du chauffeur rompt la monotonie des trois pensées parallèles qui vont chacune leur petit bonhomme de chemin… » (page 67)
La partie centrale du livre se déroule ensuite, sur le fond de l’angoisse et de la peur, avec la mise en valeur du charisme du personnage de Germaine, à l’origine une commerçante très vivante et populaire, qui évolue au fur et à mesure, se transformant en guide courageuse et, finalement, en véritable « mère Courage ».
« Au fur et à mesure que le véhicule monte, nous arrivant comme les échos de tam-tams chantants, des voix en chœur prennent corps telles des silhouettes sortant des brumes vers la lumière. »
Tandis que le paysage de ce coin d’Afrique particulièrement exubérant et beau est offusqué par l’escalade militaire et policière du premier ministre, Germaine — telle la femme de l’ophtalmologue de « Aveuglement » de José Saramago — se déplace dans le territoire avec son jeune protégé tout en lui faisant découvrir, en décalage, avec un esprit même gai et insouciant, les traditions des familles et des clans locaux lors d’événements comme des fiançailles, des guérisons et des enterrements.
« Le chauffeur accompagne des lèvres la trépidation de plus en plus distincte qui s’engouffre dans la cabine. Puis, un peu excité, il dit : — Il y a un tam-tam femelle qui fait l’amour… Oh oui ! C’est un tam-tam de peau d’agneau qui vient de Sakéta. Écoutez-moi ça, il y a de l’amour dans l’air, c’est un tam-tam de fiançailles… » (page 68) « Le chef de famille, le cousin Oladé… avait envoyé à Germaine une lettre pour la mander de venir aux fiançailles, cela fait plus d’un mois, la lettre n’est jamais arrivée à destination. Tout marche mal dans le pays. Mais Dieu est grand. Germaine est là, malgré tout. » (page 70)
Entre Germaine et le jeune homme se déclenche, en raison de la différence d’âge, un rapport assez chaste et platonique, jusqu’au moment clou du livre…
Pendant leurs excursions euphoriques et angoissées, la nouvelle éclate de la prochaine arrivée du père. Le jeune homme l’attend longuement à l’aéroport mais ne réussit pas à le rencontrer…
(Et dans ce vide de l’attente, le lecteur s’interroge : depuis combien de temps le fils n’avait-il plus revu le père ? Ce père qui lui avait fait de père et de mère en lui inculquant la voix profonde du pays ?)
Finalement, le père arrive, mais les obtus policiers l’arrêtent et l’interrogent par tous les moyens pendant une nuit. Lorsque finalement le fils retrouve le père, celui-ci meurt.
La séquence accélérée des événements justifie alors le fait le plus inattendu : le jeune fils sans larmes fait l’amour à Germaine sur un petit lit à côté de celui où repose le cadavre du père…
Si je parlais d’un film, je dirais que le climax ayant touché le diapason on pouvait bien s’arrêter là, quitte à faire jouer aux acteurs un « post-scriptum » avec la scène de la disparition violente de Germaine qui, entre-temps, avait engendré l’enfant dont elle avait inutilement rêvé au cours de toute sa vie difficile.
L’auteur avait d’ailleurs besoin d’exploiter le thème de la vengeance pour la mort violente du père. Cela se traduit en une digression ou, si l’on veut, dans une parenthèse où le jeune homme abandonne momentanément Germaine pour rejoindre, en Égypte, un ami italien qui l’aiderait à devenir un révolutionnaire combattant.
Cette parenthèse sans Germaine se transforme rapidement en vision objective d’une réalité dépourvue de charme et de vie. C’est peut-être par le regret de l’ambiance chaleureuse de son pays retrouvé que notre héros découvre son inaptitude complète : il ne sera jamais un révolutionnaire parce qu’il ne peut rester indifférent à la douleur du monde…
«…Il faut que l’homme ait un frère, une sœur, un père, une mère, il faut que l’homme ait une femme, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce. Il faut que l’homme ait un chien. Attention… Ne pas oublier le chien, l’homme et le chien, c’est spécial… Il faudra ajouter ça dans la Bible. » (page 122)
Mais il est vraiment harcelé par une destinée hostile. À la rentrée de l’Égypte il est à nouveau arrêté. Ensuite il tombe dans son même piège, se trouvant presque obligé d’achever son propos de « venger le père »… Il prend le couteau que Germaine lui a miraculeusement apporté… et poignarde le premier ministre…
En refermant le livre sur la mort de Germaine… cette femme courageuse jusqu’à l’inconscience, cette femme cultivée qui ne pouvait pas du tout partager ce sentiment obscur d’une vengeance hors de la loi…; en constatant qu’elle est tuée par les policiers parce que jugée coupable de l’agression au premier ministre… je découvre finalement la raison de son nom : elle s’appelle Germaine parce qu’elle n’est pas une mère ni une tante, mais plutôt une sœur, une sœur siamoise !
Pour conclure ce premier reportage sur « Une femme dans la lumière de l’aube » de Barnabé Laye, je dois signaler l’extrême actualité de ce livre encore aujourd’hui.
Je dis cela, bien sûr, en considération de tout ce qui se passe de terrible et d’horrible en Afrique et dans le reste de la planète de ce temps. Toutes ces tragédies insupportables trouvent dans ce texte d’inquiétantes prémonitions.
Mais aussi, dirais-je, pour cette vision dramatique, que Barnabé Laye nous confie, de l’homme coupé en deux qui voudrait voir autour de lui un monde qui revient aux sources, à l’humain, à la simplicité des communautés ancestrales, au rite de la parole et du geste.
Giovanni Merloni
(1) Au lieu de mettre le lien, je préfère copier ce que je lis dans le web…. à propos du Bénin : « Lagunes et plages bordées de cocotiers au sud, douces collines plantées de savane arborée au centre, monts arides au nord… » « Le Bénin offre un étonnant condensé de paysages africains… Mais sa richesse, c’est surtout son immense patrimoine culturel, ses traditions variées (une bonne quarantaine d’ethnies), son histoire dense et tumultueuse, bien antérieure à la présence coloniale. » « Les voyageurs le savent bien, et lorsqu’ils choisissent de visiter ce pays, c’est bien souvent pour y chercher quelque chose, faire une sorte de pèlerinage, de retour aux sources… » « Le Bénin, c’est aussi la terre du « vodoun », culte « animiste » toujours prégnant qui a essaimé au Brésil, en Haïti, à Cuba. D’ailleurs ce pays « a été marqué par la traite des esclaves, dont des millions furent déportés depuis ses côtes. » « On y rencontre aujourd’hui nombre d’Afro-américains, venus marcher sur les traces de leur histoire. » « Le Bénin vibre enfin d’une réelle vie intellectuelle et artistique. On l’avait d’ailleurs surnommé le Quartier Latin de l’Afrique. » « Quant aux amoureux des grosses bébêtes, ils pourront pousser jusqu’au nord du pays, abritant deux parcs animaliers (dont un partagé avec le Burkina Faso et le Niger). » « À signaler également : le Bénin est le seul pays d’Afrique de l’Ouest francophone à avoir effectué depuis l’indépendance des transitions politiques sans violence. »
(2) Cela arrive à tous, aux Italiens aussi. Les amis français, tout en étant fort hospitaliers et solidaires, ne cesseront jamais de nous rappeler nos origines : « vous allez en vacances en Italie, cet été, n’est-ce pas ? » « Votre bouquin se déroule en Italie, non ? »
G.M.