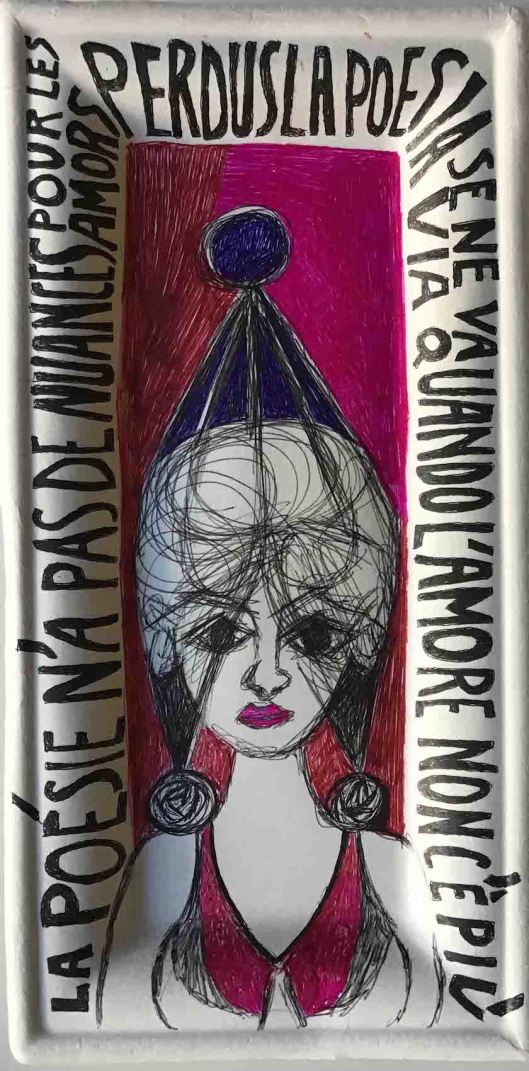Étiquettes
Aujourd’hui 11 mai 2020, jour fatidique du « déconfinement » en France, je publie un texte que j’avais écrit pour la Ronde du 6 avril dernier, autour du thème « silence/s », publié ce jour-là sur le blog « La dilettante » de ma très chère amie Marie-Noëlle Bertrand (@eclectante).
G.M.
LA CURE DU SILENCE
« Quand Isabelle dort plus rien ne bouge »
Jacques Brel
Pendant ces jours qui vont devenir des mois, nous nous découvrons tous plongés dans la même pensée (qui n’est pourtant pas une « pensée unique”) formant en chacun de nous un épais nuage de silence.
C’est d’abord le silence de tout ce qu’on ne doit même pas murmurer, puis le silence des mots qui ne seraient pas nécessaires ni opportuns, enfin le silence qui ne brise pas le silence qui règne au-dehors de nous par une voix déplacée, par un accent exagéré, par une gaffe, soit-elle insignifiante même.
Notre silence, tout comme le silence au-dehors, ce n’est pas le résultat d’un vent destructeur mais, au contraire, la prouve vivante de notre capacité, individuelle et collective, de résister respectueusement à la peur… qui, à son tour, est en train peut-être d’apprendre à s’exprimer silencieusement, essayant de ne pas faire du bruit quand elle doit sortir de son redoutable silence ou lorsqu’elle comprend que l’heure est venue d’y rentrer vite.
Le silence devient ainsi la ressource extrême où les humains vont puiser pour être en mesure de supporter le chagrin que déchaîne le silence de ceux et celles, autour de nous, qui disparaissent à jamais, ajoutant leur silhouette invisible aux sombres statistiques du silence.
Chacun de nous a donc besoin d’une provision supplémentaire de silence, voire d’un endroit silencieux et secret, installé à mi-chemin entre le cœur et l’esprit, pour y héberger la douleur pour ces frères humains qui meurent à notre place, s’écroulant un à un, qui sait où, dans une silencieuse bataille qu’il ont dû se résoudre à combattre du jour au lendemain, sans transition, pour avoir offert un seul baiser, pour avoir serré une seule main ou alors pour avoir aidé, un jour, un autre être humain à se lever et marcher.
Tout cela ne jaillit pourtant pas, dit-on, de l’invention de quelques esprits malades. Pendant que coulent physiquement autour de nous des jours étranges, pourtant foudroyés par une inattendue beauté printanière, l’ancien vacarme de la ville essaie de se faire oublier ou bien s’approche timidement de notre fenêtre, sur la pointe des pieds, pour ne pas déranger le silence éphémère de notre prison large ou étroite.
Demeurer en silence c’est finalement le moindre mal, un seuil invisible que nous apprenons à ne pas franchir, pour sauver nous-mêmes ainsi que les autres, évitant de les traîner dans le gouffre, rien que par un seul geste d’amour.
Cependant il reste debout, ineffaçable en chacun de nous, le désir de revivre le plus tôt possible ce geste, avant d’arpenter un à un les lieux où le pas des autres ne nous faisait pas peur, où leur voix nous attirait par sa chaleur unique et sa prodigieuse essence vitale.
D’ailleurs, nous ne pouvons pas nous empêcher de rêver, en dépit des bornes physiques et mentales de notre enfermement. Par exemple — en cachette, dans un cagibi de l’esprit que j’ai bâti tout seul avec les armes patientes du silence —, je me vois confortablement assis dans une voiture à pédale où des hommes très adroits ont appliqué, à la place des roues, des skis de bois parfaitement lisses et silencieux.
En cette hypothèse, aussi hasardeuse qu’hantée de clairvoyance, le moindre bruit serait préjudiciable au succès ainsi qu’à la première timide démarche de mon entreprise farfelue.
Et voilà que dans mon cagibi, sans faire de bruit, un vent gelé s’est faufilé, tandis que le grand hublot bleu, lui aussi en silence, demeure scandaleusement ouvert sur le vide.
De là-haut, nous pourrions glisser, mon traîneau et moi, avec la certitude de tomber sur un boulevard parfaitement blanc, lisse comme s’il y avait une épaisse pellicule de neige et bien sûr silencieux.
Si le blanc est la synthèse de toutes les couleurs, le silence est la grande couche où tous les bruits de la terre s’estompent… cela revient à une intime évidence :
« Le blanc est la couleur même du silence ! »
En sortant par le grand hublot bleu de mon cagibi, je vais sans doute découvrir qu’il n’y a aucune solution de continuité entre mon silence intérieur, le silence de la ville et le silence du monde.
En un éclair, une fois rattrapées les portes les plus éloignées de Paris, je vais découvrir aussi qu’au-dehors d’elles on respire le même silence.
Un silence qui parle.
Un silence qui retient le souffle.
Un silence désespéré et indomptable à la fois.
Un silence qui m’exhorte pourtant à être sage, à ne pas commettre le sacrilège si longuement échafaudé de rendre visite un à un à tous les endroits que je connais autour de moi, en m’approchant des portes où d’autres personnes — connues, inconnues, peu importe — savourent le même silence que moi… et frapper, même de façon imperceptible, par un toc toc que n’importe quelle autorité jugerait en dessous du seuil de silence autorisé.
Cela déclencherait inévitablement un vacarme endiablé qui tout de suite après se propagerait comme une maudite inexorable contagion.
Et l’on perdrait toutes les vertus du silence.
Donc, en attendant que tout le monde se réveille guéri, je renonce au privilège de cette petite pièce luxuriante et décide, en me taisant, de faire tout ce que je peux pour que cette immense, invisible étendue de maisons et de rues, de terrains vagues et de champs demeure paisiblement effondrée dans le silence.
Parce que personne n’a jamais su aussi bien écrire que se taire. Parce que celui qui se tait donne, par le silence, son accord à la cure du silence. Parce que le silence est d’or.
« Sinon, j’ai toujours su que tout ce qu’on peut « éviter » — en faisant recours à notre esprit de conservation ainsi qu’à la force de notre amour pour les autres frères humains — va rendre sans doute moins « inexorable » toute vague destructrice et meurtrière dont la science et l’intelligence des hommes généreux est toujours en condition de connaître et maîtriser la portée. »
Giovanni Merloni
LA CURA DEL SILENZIO
« Quand Isabelle dort plus rien ne bouge »
Jacques Brel
In questi giorni che diventano mesi ci troviamo tutti a pensare, credo, le stesse cose. O la stessa cosa, che forma una spessa e quasi tangibile nuvoletta di silenzio dentro ognuno di noi.
Il silenzio di tutte le cose che non si debbono dire, che secondo noi non è bene dire, innanzitutto per non rompere il silenzio che è fuori di noi con una voce stonata, con un accento sbagliato, con una anche piccolissima gaffe.
Il nostro silenzio, come quello di fuori, non è il risultato di un vento devastatore ma, al contrario, la prova della nostra capacità individuale e collettiva di resistere rispettosamente alla Paura… che, a sua volta, sta forse imparando a esprimersi silenziosamente, facendo attenzione a non fare rumore quando deve per forza uscire dal proprio terribile silenzio o quando capisce che è venuta l’ora di rientrarvi in fretta.
Il silenzio si rivela così l’estrema risorsa a cui possono attingere gli umani per poter sopportare il dolore provocato dal silenzio di coloro che intorno a noi, chissà dove, spariscono per sempre, andando ad aggiungersi alle cupe statistiche del silenzio.
Ognuno di noi ha dunque bisogno di una provvista supplementare di silenzio, ovvero di un luogo silenzioso e segreto, situato a metà strada tra la mente e il cuore, dove ospitare il dolore per la scomparsa di coloro che ci lasciano per morire al posto nostro, cadendo uno a uno, chissà dove, in una silenziosa battaglia che si son trovati a dover combattere dall’oggi al domani, senza transizione, per aver dato un solo bacio, per aver stretto una sola mano o per aver aiutato, un giorno, un altro essere umano ad alzarsi e camminare.
In questi giorni strani che non scaturiscono, purtroppo, dall’invenzione di qualche mente malata ma scorrono fisicamente intorno a noi con una loro inattesa bellezza primaverile, l’antico rumore della città cerca di farsi dimenticare o si affaccia timidamente, sulla punta dei piedi, per non disturbare il precario silenzio della nostra piccola o grande prigione.
Il nostro stare in silenzio è dunque il male minore, una soglia invisibile, che ci stiamo abituando a non varcare, per salvare noi stessi e tutti gli altri esseri umani possibili e immaginabili che noi stessi potremmo trascinare nel baratro, magari per un solo gesto d’amore.
Ma resta vivo, insopprimibile in ognuno di noi il desiderio di rivivere al più presto quel gesto e di ripercorrere uno a uno i luoghi dove il passo degli altri non ci faceva paura, dove le voci ci attiravano con tutto il loro calore e le loro essenze vitali.
Non possiamo impedirci di sognare, pur nei limiti fisici e mentali del nostro « enfermement ».. Per esempio, a me piace, in segreto, in un cagibi della mente che mi sono da solo costruito con le pazienti armi del silenzio, immaginarmi seduto su una antica carrozza dove, al posto delle ruote, qualcuno che lo sa fare ha applicato una slitta perfettamente levigata e silenziosa.
In questa mia azzardata e forse antiquata ipotesi, ogni rumore potrebbe pregiudicare l’esito o anche la sola messa in pratica della mia stramba iniziativa.
Dunque nel cagibi è entrato, in silenzio, un vento gelato e una porta si è aperta silenziosamente sul vuoto.
Da lì potremmo scivolare, io e la mia slitta silenziosa, certi di trovare il boulevard perfettamente innevato e silenzioso. Il bianco è la sintesi di tutti i colori come il silenzio è la grande coltre dove sono assorbiti tutti i rumori della terra (direi perfino che « il bianco è il colore del silenzio »).
Partendo, scoprirei che non c’è nessuna soluzione di continuità tra il mio silenzio interiore, il silenzio della città e il silenzio del mondo.
In un baleno raggiungerei le porte estreme di Parigi e scoprirei che anche fuori di esse si respira lo stesso identico silenzio.
Ma sarebbe per me un sacrilegio, ritrovare uno a uno tutti i luoghi che conosco intorno a me, avvicinarmi alle porte di tutte le persone che come me stanno bene o male assaporando il mio stesso silenzio e bussare, anche impercettibilmente, con un toc toc che qualsiasi autorità considererebbe al di sotto della soglia di silenzio consentito. Provocherei un baccano che subito si propagherebbe come un maledetto contagio.
E si perderebbero tutte le virtù del silenzio. Dunque io rinuncio al privilegio di questa stanzetta segreta come al più scandaloso dei lussi e, tacendo, decido di fare la mia parte in questa immensa invisibile distesa di case e strade sprofondate nel silenzio.
Perché un bel tacer non fu mai scritto. Perché chi tace acconsente fieramente e orgogliosamente alla cura del silenzio. Perché il silenzio è d’oro.
Giovanni Merloni