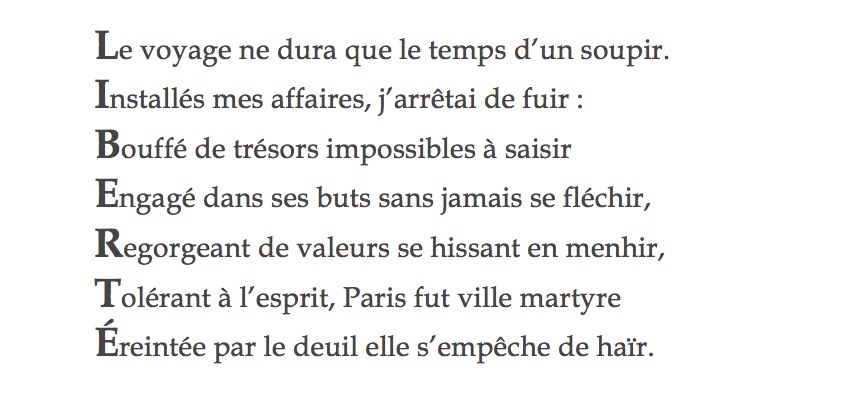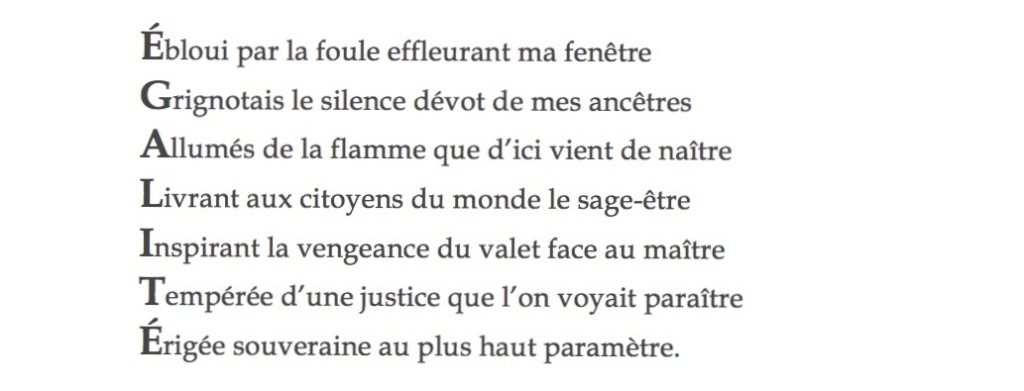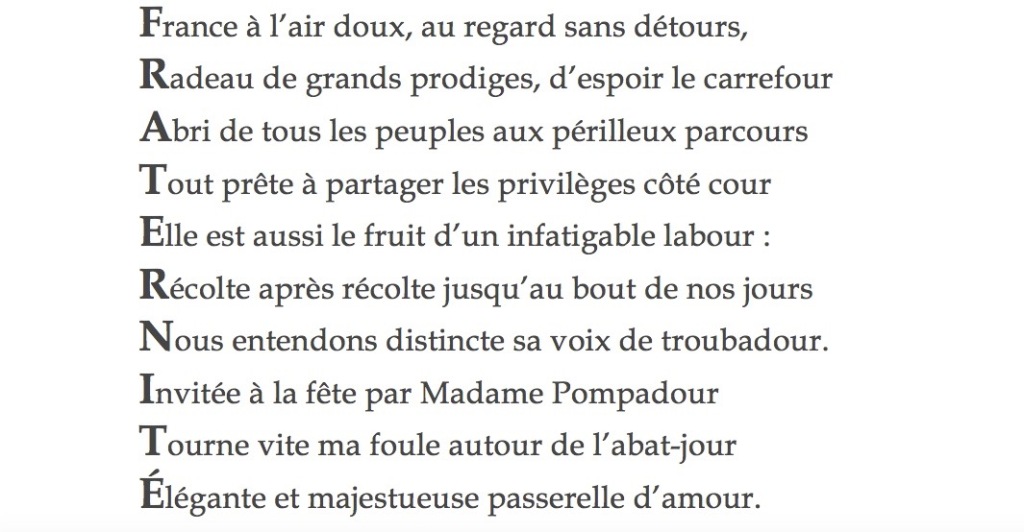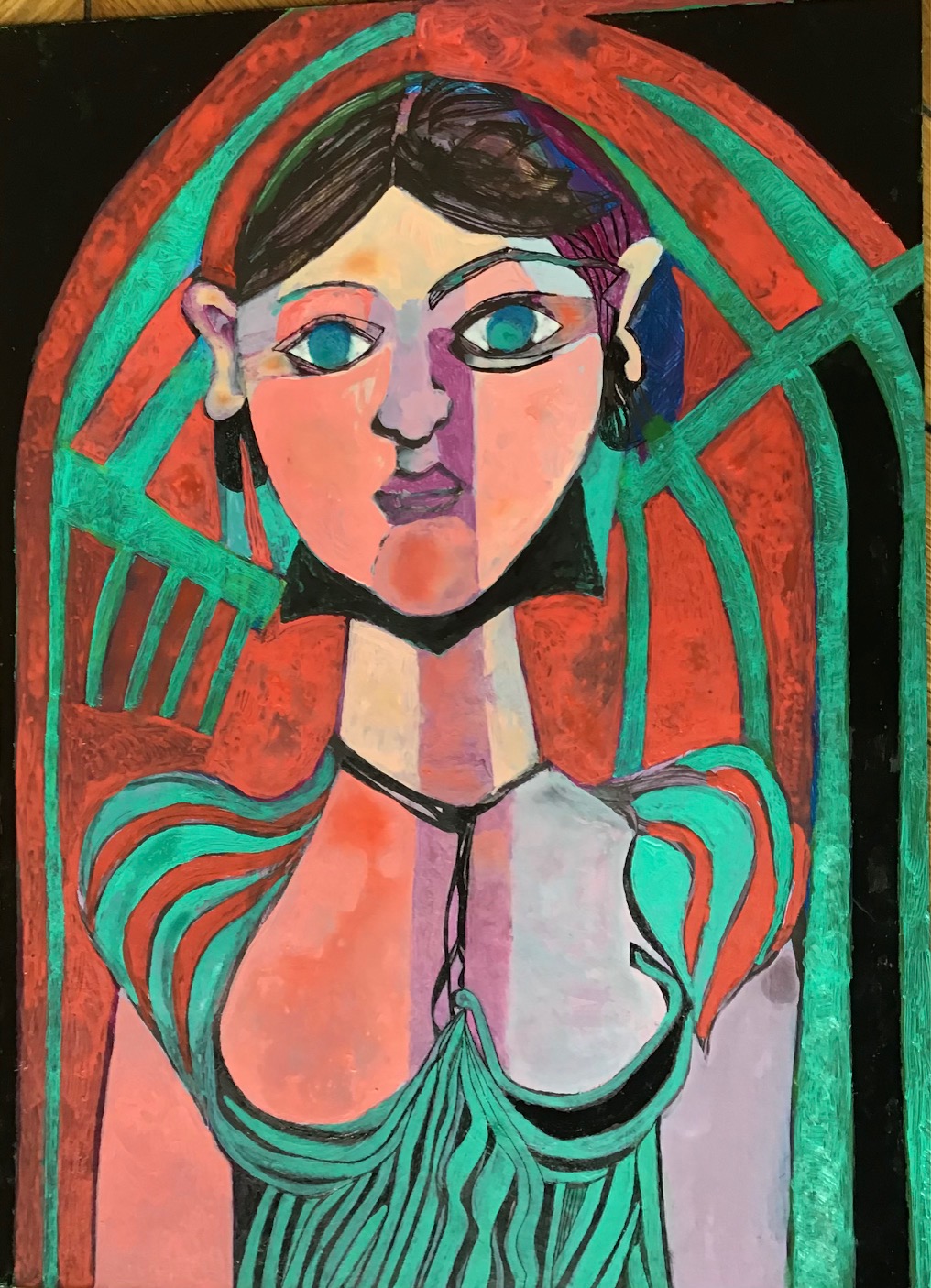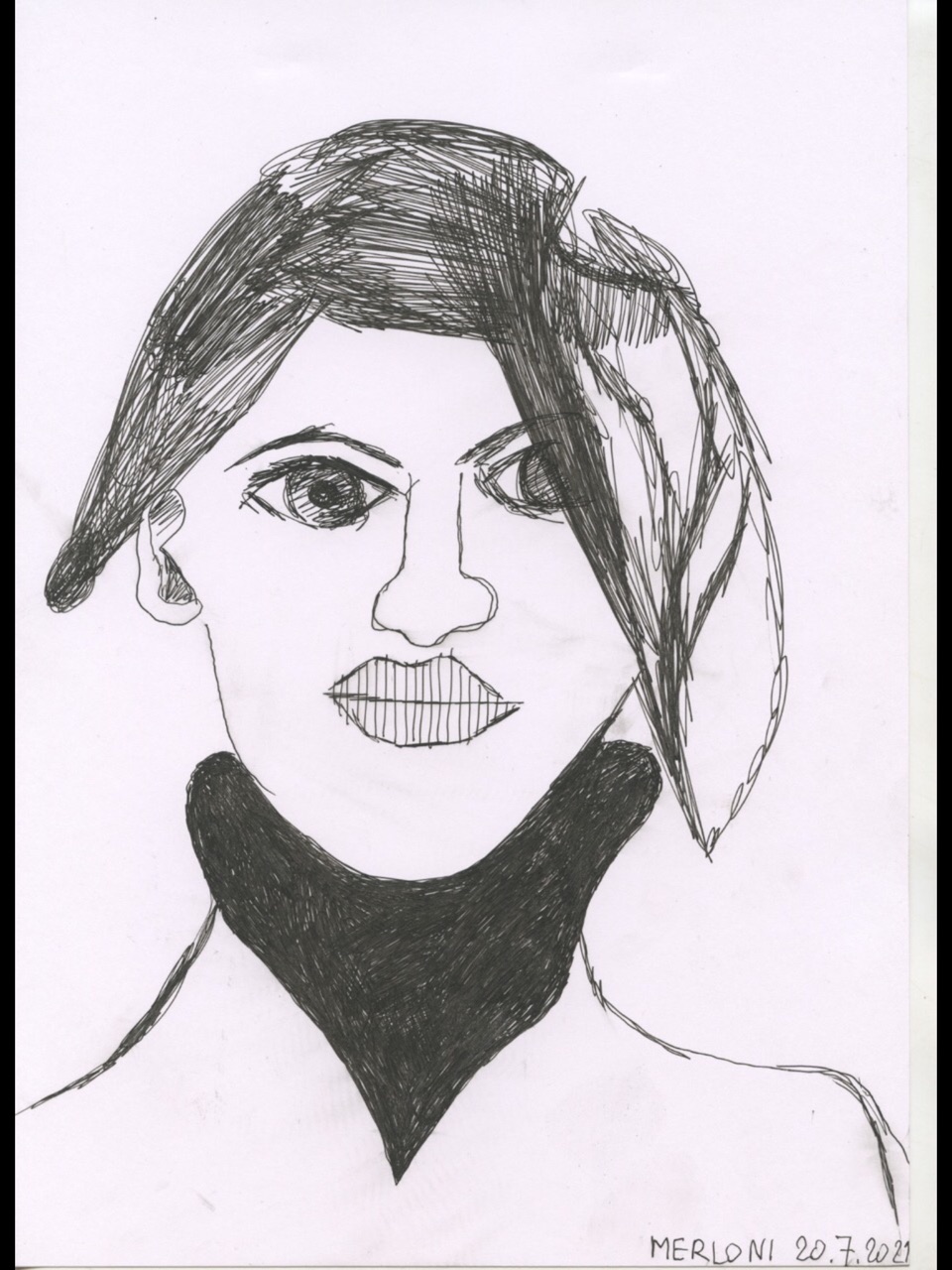Promenade librement inspirée par les extraordinaires photos
(de véritables tableaux) d’Anne-Sophie Barreau
à l’enseigne de la télépathie — toujours à la recherche
d’une bouée de sauvetage pour tous ceux qui tombent dans
un puits (pendant le jour ou la nuit) et ne savent pas nager.

Admettons que ces tableaux soient porteurs d’une histoire
en dehors de l’histoire d’un pays façonné aux tempêtes
au froid, à l’humidité qui tout pénètre, intimement,
comme une nécessité ;
en dehors de la petite histoire d’un étranger
qui encore très peu connaît de la brume
qui se colle, grise, au ciel et aux maisons,
de cette campagne s’effondrant dans la nuit aquatique,
de cette ville de lumières et chaleurs bien cachées
dans les coulisses éphémères d’auberges bruyantes…
Est-ce que ces tableaux vont aussi raconter,
en raccourci, par d’infimes traces déguisées,
par le biais de la nuit et de la pluie,
notre histoire inconnue, pour la dévoiler enfin
lors des jours de soleil ?

Non, ces tableaux sont les baisers volés d’une histoire oubliée,
d’une longue promenade au loin d’une fenêtre allumée
avant de se décider à monter à l’étage. Ou alors,
s’agit-il de sombres miroirs où s’accoude,
soudain, par hasard, un visage souriant.
Sinon, notre histoire s’arrête à ce sac paresseux
voltigeant derrière Elle, tandis qu’elle se sauve,
en quête de quelqu’un qui ne l’attend pas.
Mais au bord de la gommeuse uniformité
qu’elle traverse, on découvre le soleil,
le halo pâle du jour, dont elle s’échappe
pour atteindre la nuit, ses étranges mystères.

Néanmoins, rien n’est plus fascinant qu’une porte fermée,
à côté d’un sinistre rideau de fer rabattu : cette lumière
rasante, si ressemblante à la lueur chaude d’un foyer,
pointant, au loin, dans le bois de la fable,
est-ce le rayon de l’aube ? est-ce l’éclat envahissant
des feux pompeux d’une auto ? un vaniteux, vieux réverbère ?
Est-ce qu’ils nous ouvriront ?
Est-ce que tu te souviens
du Sésame ouvre-toi, de l’Abracadabra,
de l’Alhambra, de l’Oiseau rebelle… du Code ?
où as-tu caché tes clés ?

Entrons ! Par cette chaude clarté
inondant le marbre de la marche,
la porte semble nous inviter, du moins à attendre,
ratatinés dans un coin pour ne pas déranger.

Si, au contraire, ces images rêveuses sont là
pour nous réapprendre, au-delà des contingences,
au-delà de la peur, au-delà des chagrins personnels
et collectifs ce que nous risquons d’oublier, harcelés
comme nous sommes par des machins sans âme,
obsédants, répétitifs, standardisés ?
En revanche, arpentant la poésie de ces
tableaux notre esprit se libère, jusqu’à faire table rase
de ces affreux cauchemars, réapprenant à marcher,
à effleurer les lueurs de la nuit,
les ombres colorées de la lumière.

On nous octroie la sagesse d’une véritable initiation
à la grandeur de la vie, où le regard du photographe
se déguise en Virgile : nous ne sommes pas seuls
dans l’enfer de la nuit, ni dans son purgatoire.
Ce coup d’œil pénétrant, nous apprend à saisir,
avec émotion, la lumière dans la nuit,
la nuit dans la lumière, nous autorisant le courage
de donner des coups de pied à notre impuissance
face à ceux qui conspirent
contre la beauté désemparée de la vie.

Poursuivant de passage en passage
nous devenons complices de rituels quotidiens,
d’inatteignables transgressions, d’histoires
sans doute redoutables. S’agit-il des images ultimes
de mondes glorieux, hantés, à leur époque,
de passions foudroyantes, d’amourettes fatales ?

Hors de l’impasse, abasourdis sinon euphoriques,
une sensation aiguë s’était emparée de nous
— nous n’avons jamais eu
un véritable but, dans notre vie fragile et protégée —
quand, aussi soudaines qu’inattendues,
des plantes et des fleurs nous ont chatouillés,
inondant de fond en comble la maison-sac à dos
qu’à outrance nous portons, la maison défunte
des sourires, des collations, des chansons, de sincères
baisers qu’on nous offrait sans réserve, et pourtant
disparaissent à jamais.

Il nous réconforte aussi ce blanc sale,
déjà gris, des parois qui se décollent, de ces volets
monotones qui semblent cacher un amour emporté,
intense : exactement ce que nous avons longuement
rêvé. Sommes-nous donc des voyeurs ? Ou alors
sommes-nous en train de nous accrocher à la vie
qui ne cesse, elle, de nous promettre
la solitude de la mort ?

Exactement, tel un coup dans le ventre,
la lumière se révèle par cette ombre en filigrane
ressemblant à une guirlande fanée, entourant
le petit lustre qui serait à l’intérieur… qui sait ?
si je frappe doucement, un mari va m’ouvrir.
Il protestera, il aura peur. Ou alors il répliquera,
par hurlements et menaces, au-delà
de la fenêtre fermée. Ou sinon, pourquoi pas ?
avec circonspection, sa plus jeune fille m’ouvrira,
à demi endormie, arborant ses longs cheveux blonds.
Mais elle ne sourira pas. Aussitôt, en s’écriant :
« maman ! », elle me claquera la persienne au nez.
Chacun de nous, la nuit, se découvre seul, naufragé,
à la recherche tenace du chaud.

Belle nuit, finalement, lorsqu’on se rend compte
que la rue est notre force, notre destin : cette rue
où se promènent les ombres, se racontant d’histoires
de petites incompréhensions, de grandes tragédies
d’histoires de craintes effleurant les nôtres,
se mêlant avec elles. La rue est enfin
notre corps étranger qui nous devient familier,
c’est sa voix péremptoire, nous obligeant à sortir
de cette solitude béate pour broyer un sandwich,
pour se faufiler, effrayés, en des toilettes sordides
ou propres, pour dormir en cachette, avec un œil
ouvert, dans la salle d’attente d’une gare.

Accueillante et bénéfique est pourtant cette halte
que la rue nous octroie au milieu du brouillard, peu
importe si le banc public s’affiche froid ou mouillé :
nos membres aux extrêmes vont s’y recomposer,
tout comme le tourbillon de nos pensées et nos
battements de cœur. À propos, en vous y établissant,
ne vous êtes pas aperçus du silence prodigieux
qui l’entoure ?

Reprendre la route ce n’est pas que traverser le noir et
la pluie, pas non plus qu’aller en avant, essayant de ne pas
tomber. Il ne s’agit pas que de tourner le coin de la rue
pour en prendre une autre : la rue est aussi dévier du plaisir
de nous perdre, arrêtant une décision, un raccourci,
nous agrippant à une rampe de Montmartre même si
nous ne saurons jamais que cette ville est Paris.

Remonter, revenir, c’est ça la rue. Cela n’a aucune importance
de savoir que nous sommes en train de rentrer chez nous,
car nous pourrions tout également revenir là où nous n’avons
jamais eu de maison, là où personne ne nous attend.

Et voilà l’envoûtante sortie du métro Rome !
Que ce soit la nuit ou au petit matin,
l’on se sent solidaire, en débouchant sur Belleville, ou
Ménilmontant, ou Richard Lenoir, envers ces autres
humains, peu importe s’ils sont méfiants ou indifférents :
la rue c’est les couleurs que la lumière peigne
sur les boutiques, sur les enseignes, sur nos vêtements
extravagants: les couleurs du hasard nous ayant emmenés
dans un lieu où l’on voudrait rester.

À contre-cœur la rue nous réveille, nous laissant découvrir
que nous vivons encore. Par la chaleur d’un café brûlant
et d’une tartine, bien sûr, nous sortirons du silence :
pour l’heure, nous laissons le regard se complaire,
voltigeant au ras du sol sur les petits tessons colorés
du passage gracieux. Entre-temps,
nous écoutons les voix et les bruits
du nouveau jour qui en bâillant, ouvre les yeux.
Et, peut-être, il y a quelqu’un, là-dedans, qui nous parle,
qui nous offre sa main.

Ultime étape : à l’abri d’une inédite spontanéité,
la rue nous aide à regarder, de d’intérieur et de l’extérieur,
notre vie comme une fresque, comme un dessin que le temps
rend flou, qu’affligent de petites rouilles, des contours
inégaux ; une œuvre ô combien révolue
que sauve un miracle, lui gardant ses couleurs
encore vives. La rue nous observe
tandis que nous y jetons, comme poubelle,
cette chose seule que nous possédons,
ce corps rêveur que nous négligeons,
que nous malmenons. La rue nous sauve, juste à temps,
nous obligeant à rattraper la vie, ce lourd fardeau
d’erreurs fatales, avant que nous la donnions à tout venant
pour qu’il l’ensevelît dans son ineffable sourire.
Giovanni Merloni